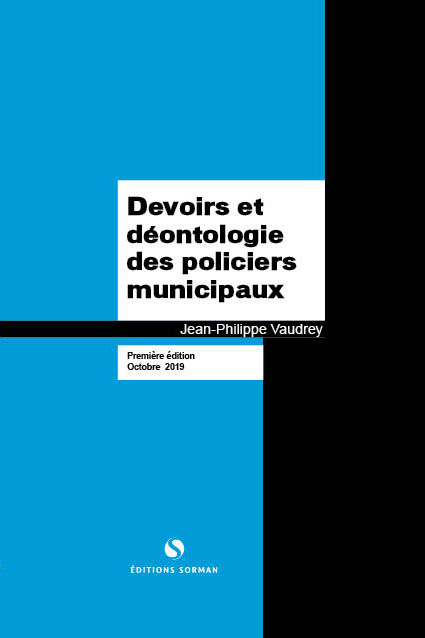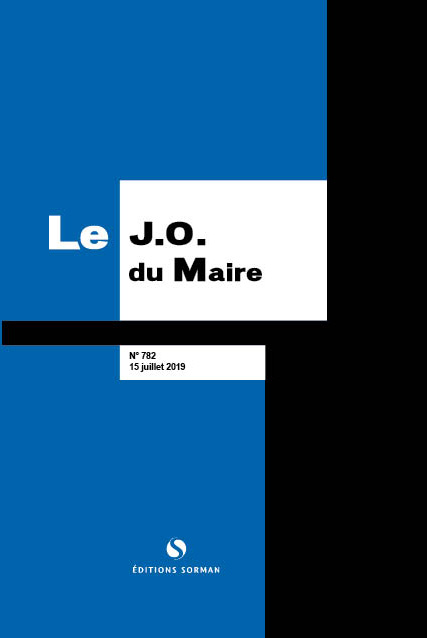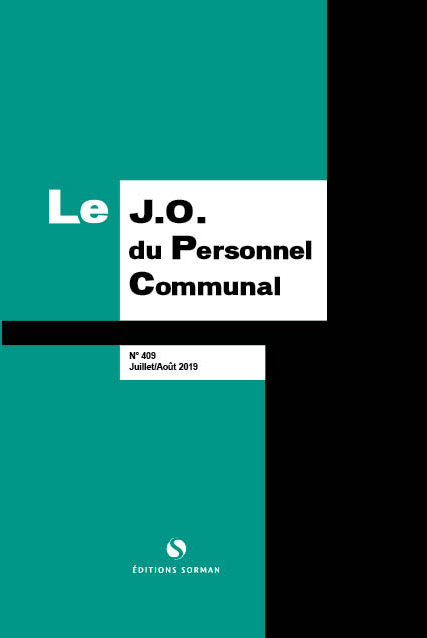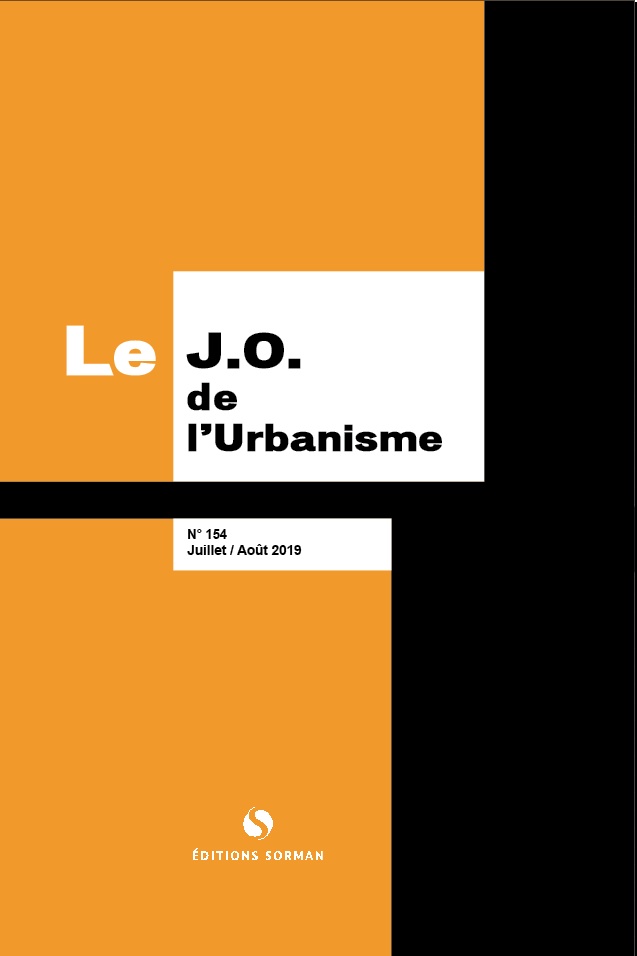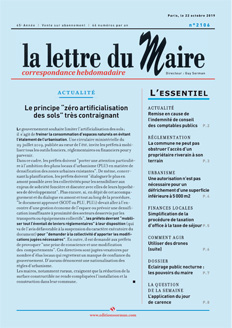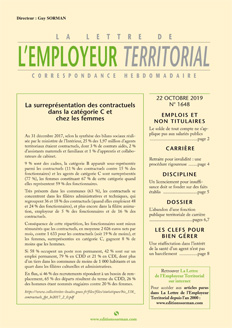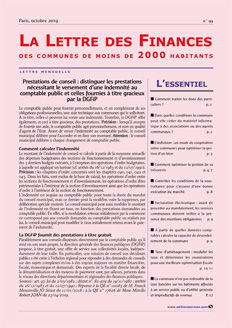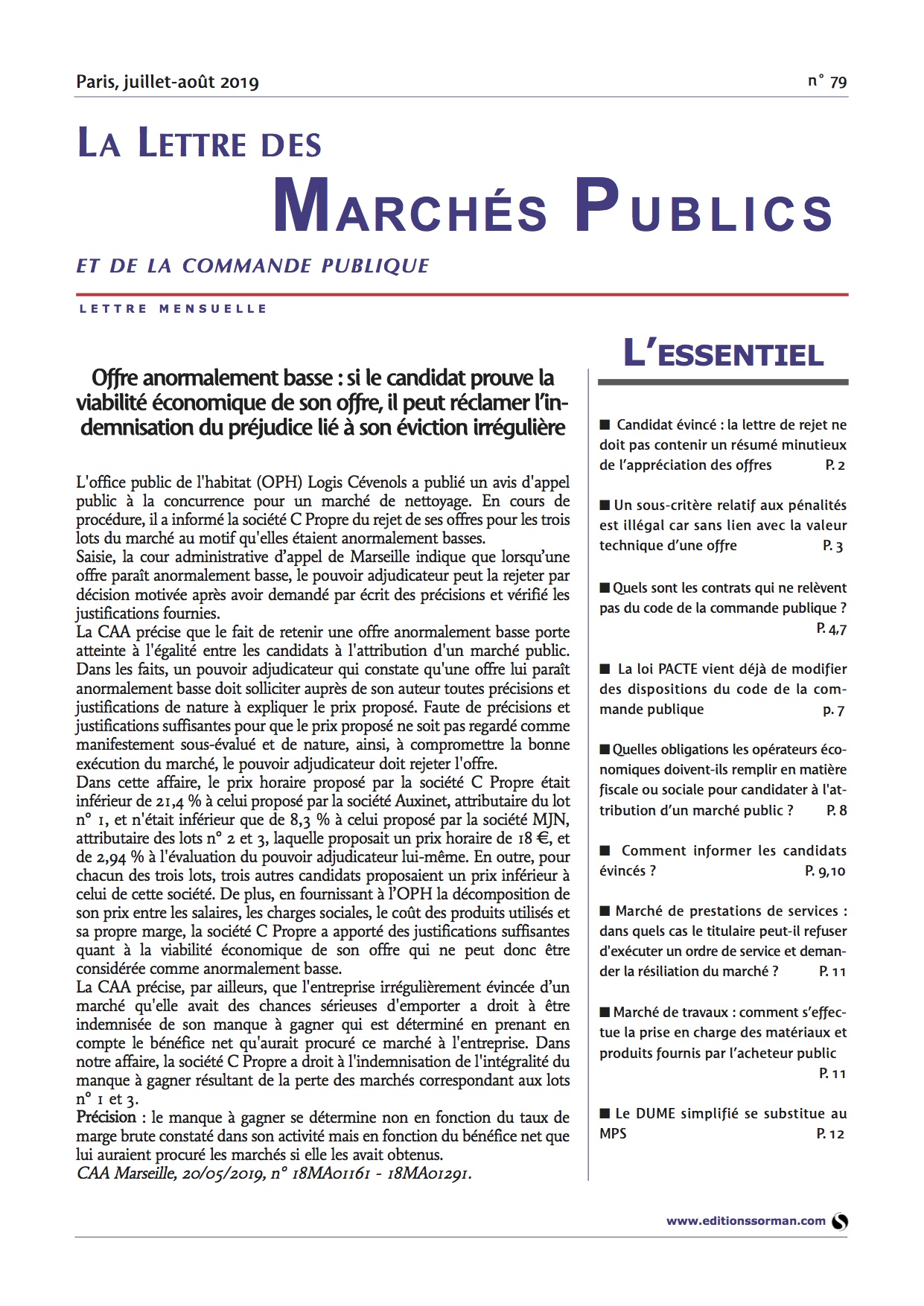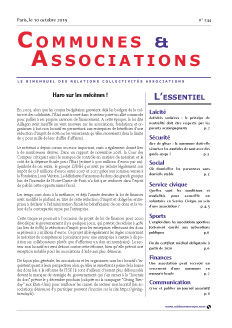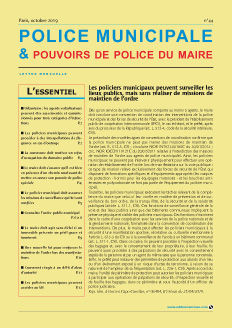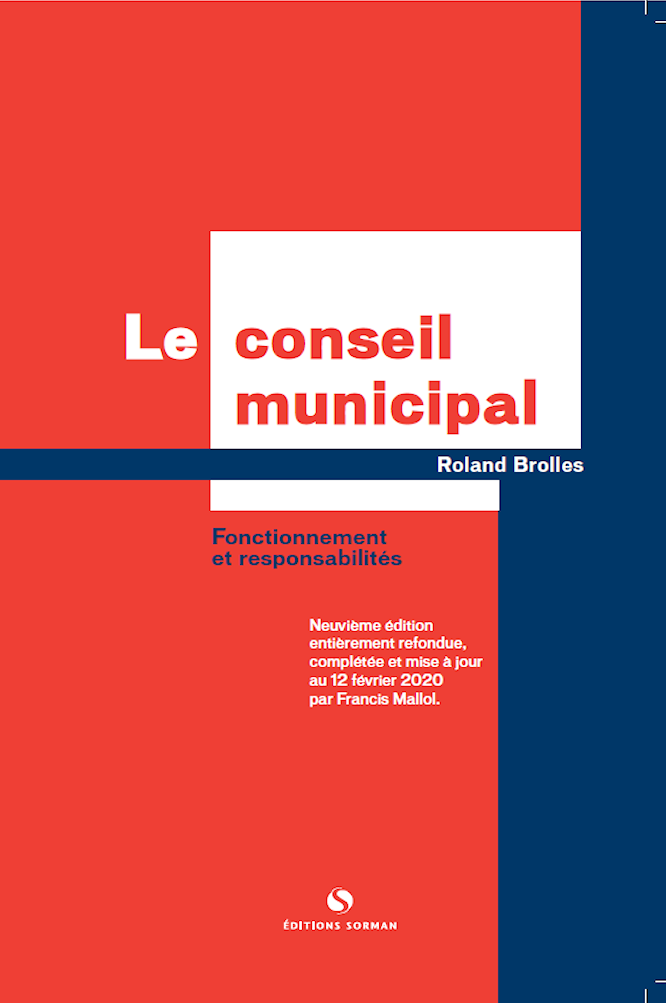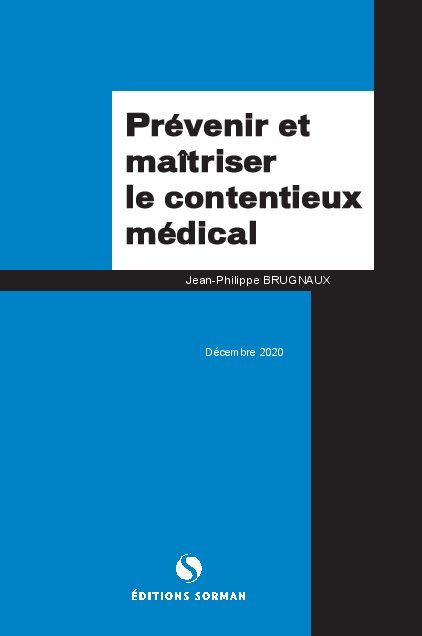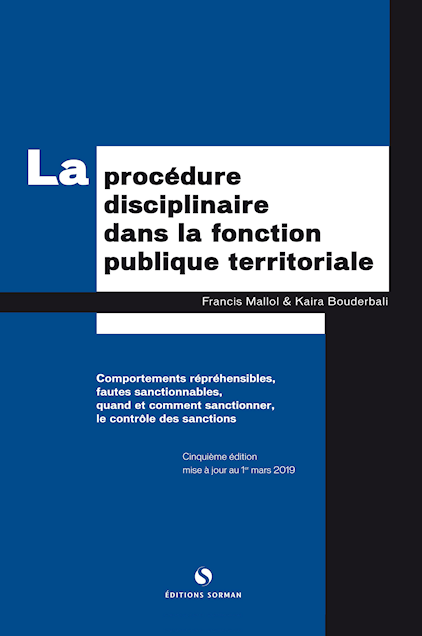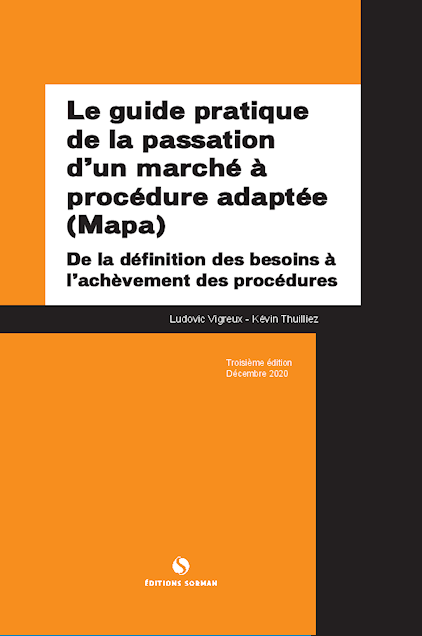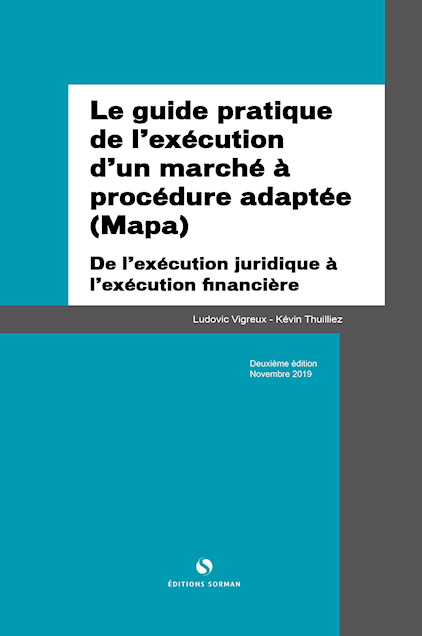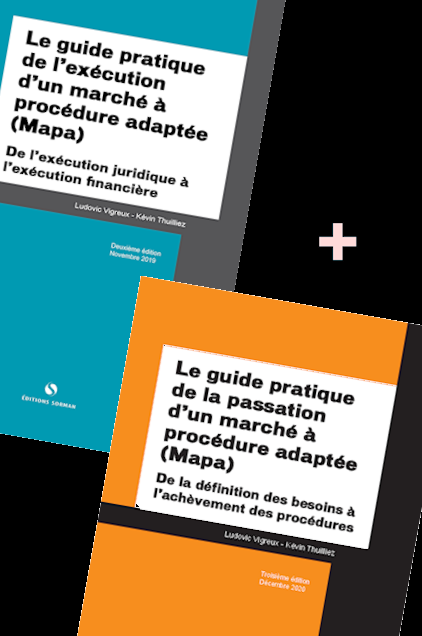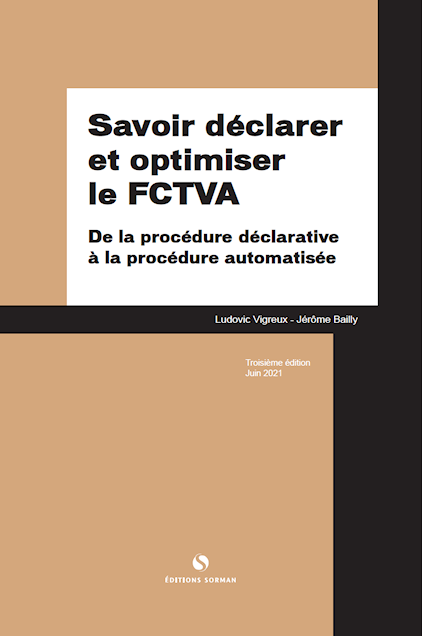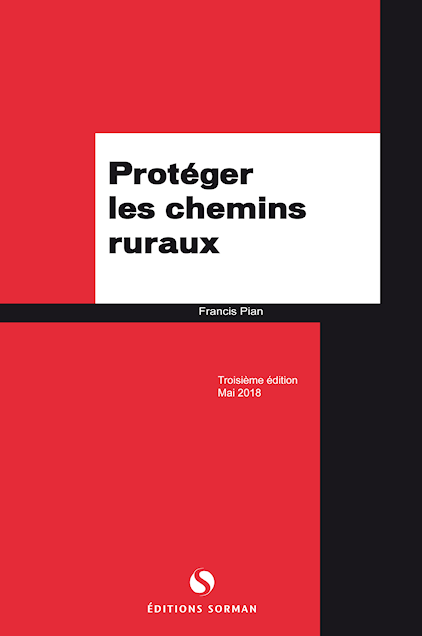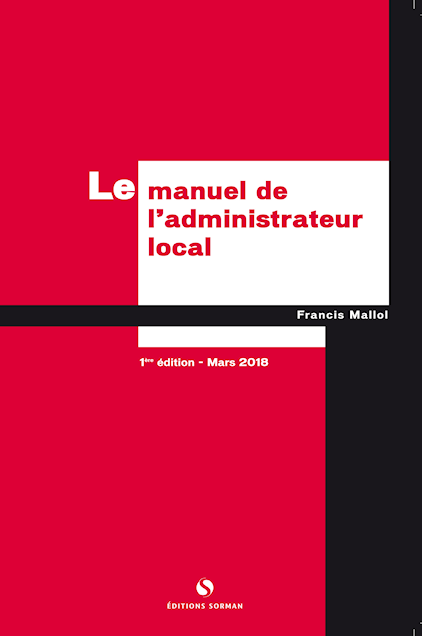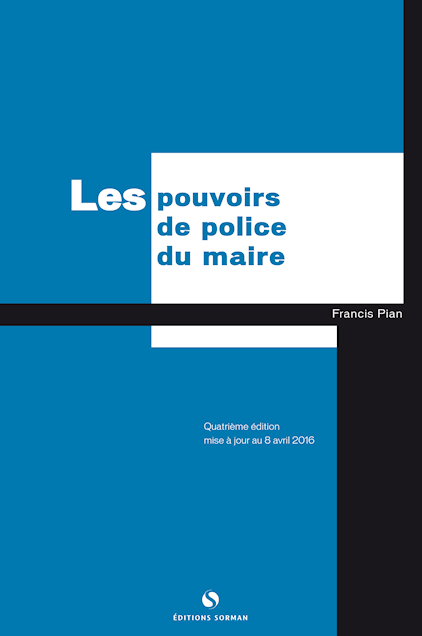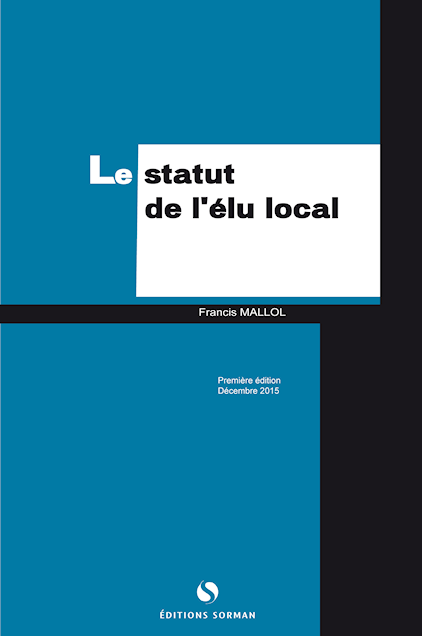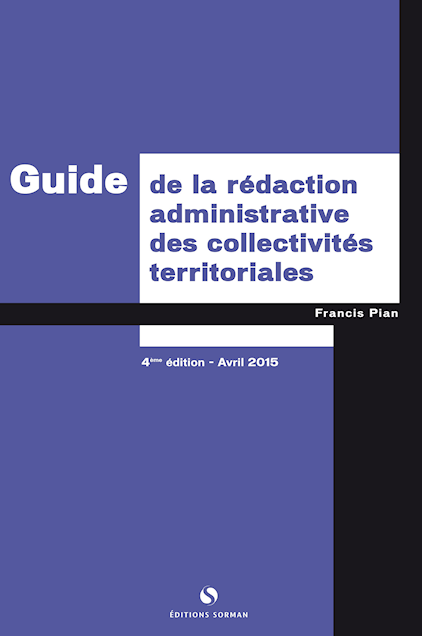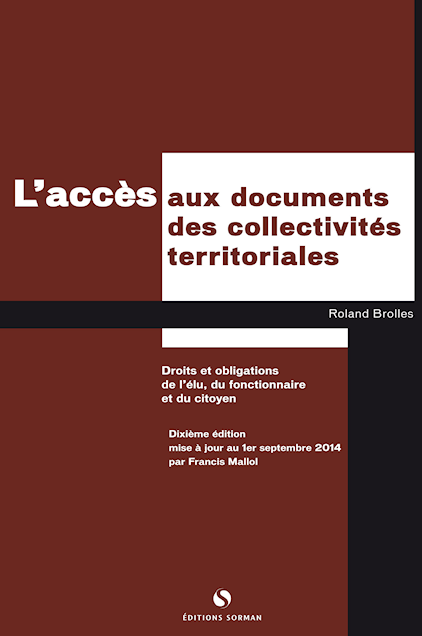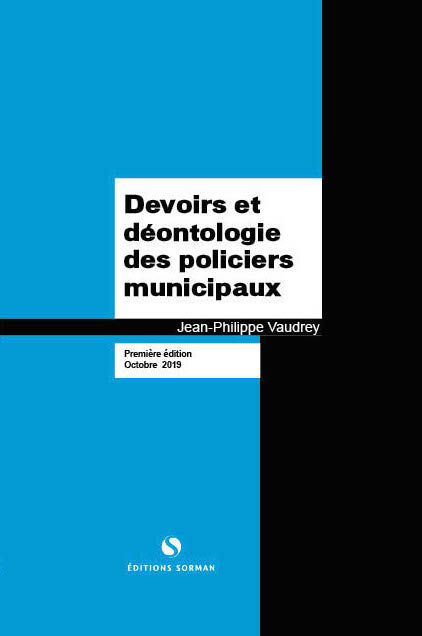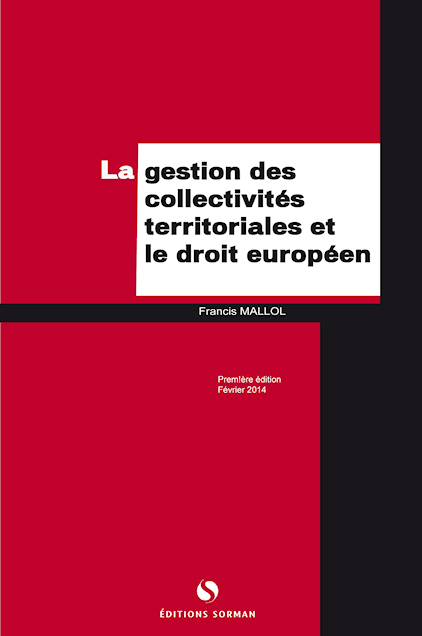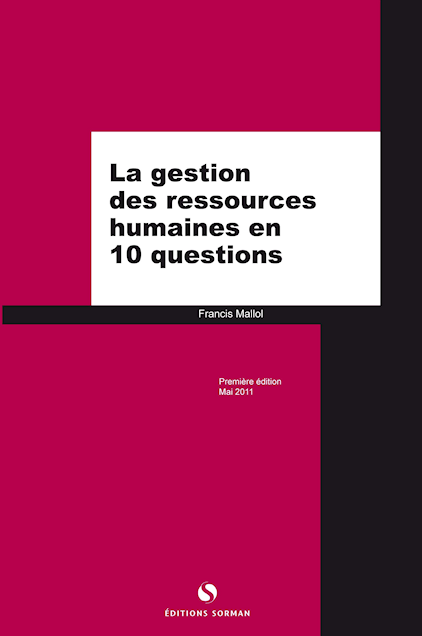Les petites installations d'assainissement innovent dans le traitement individuel des eaux usées Abonnés
Cinq millions d’installations d’assainissement non collectif à contrôler
La France compte 5 millions de dispositifs d’assainissement non collectif (ANC), qui traitent les eaux usées domestiques de 12 millions d’habitants non raccordés au réseau ; 80 % des installations déjà contrôlées présentent des défauts de conformité, et 20 % un défaut majeur.
Pour les installations existantes, le contrôle du SPANC porte sur l’appréciation du risque sanitaire et environnemental. Mais beaucoup ne peuvent pas être correctement contrôlées, en raison de l’impossibilité d’accéder au dispositif de traitement. Et, bien que la responsabilité du maire entre en jeu, ses moyens d’action restent limités. En cas de non conformité caractérisée (fuites de matières, résidus de papier hygiénique à l’exutoire), la sanction relève de la police de l’eau, assurée par la MISE (mission interservices de l’eau), qui dépend des Directions départementales des territoires.
La fiabilité du certificat de bon état et de bon fonctionnement de l’installation existante, produit lors d’une mutation immobilière, est également variable.
Afin d’améliorer le contrôle de conformité, un référentiel est en cours d’élaboration avec l’Afnor et les professionnels.
Les opérations de réhabilitation portées par les collectivités et les Agences de l’eau sont donc essentielles. Mais, selon André Flajolet, président du Conseil national de l’Eau, le rôle du SPANC ne doit pas se limiter à suivre le matériel installé ; il faut également constater son efficacité, matérialisée par le pourcentage de pollution abattu.
Pour les constructions neuves, la proposition de solution d’assainissement, incluse dans le volet spécifique du dossier de demande de certificat d’urbanisme ou de permis de construire, est soumise au technicien du SPANC. Mais, dans la majorité des cas, il n’y a pas de réception des travaux pour vérifier l’installation.
Investig’+, outil de diagnostic
La mise au point d’Investig’+ résulte d’un partenariat entre le Cemagref, l’université de Clermont-Ferrand et Veolia Eau. Partant du constat que 80 % des installations existantes, massif filtrant ou dispositif d’épandage, sont difficile à contrôler, à l’inverse des cultures libres ou fixées, aisément accessibles, les partenaires ont breveté un outil de diagnostic, Investig’+, qui permet de constater, sans le détruire, l’état et le fonctionnement d’un massif filtrant, par la combinaison de 5 outils :
- la mesure de la résistivité permet de localiser et de dimensionner la surface du massif ;
- le pénétromètre Panda caractérise la nature et la hauteur des constituants du massif (terre, graviers, sable), par enfoncement de tiges ;
- l’endoscope (caméra miniaturisée circulant dans une tige creuse) constate la granulométrie et l’état du sable filtrant, pour établir le niveau de colmatage ;
- la mesure de gaz vérifie l’activité biologique dans le massif, indice de bon fonctionnement de l’épuration ;
- l’abattement des pollutions se mesure sur des bandelettes en sortie du massif.
Le traitement des informations collectées donne lieu à un rapport de diagnostic. La conformité et le fonctionnement des matériaux filtrants s’apprécient par rapport à la norme XP DTU 64-1 : le fonctionnement du massif s’évalue sur la perméabilité du sable, la saturation en eau, la teneur en oxygène, le colmatage ; l’efficacité de l’épuration s’apprécie par l’évaluation du traitement de l’azote. Le diagnostic Investig’+ informe sur les dysfonctionnements, par exemple un déséquilibre d’alimentation du filtre, le colmatage étant concentré sur une seule zone.
L’intervention complète sur le terrain prend 3 heures, pour un coût de 400 €, traitement informatique inclus. Une version simplifiée (4 points de mesure en 1 heure) est destinée à la cession immobilière.
Dans les Hautes-Pyrénées, le SPANC des communes de Gardères, Luquet et Séron a délégué à Veolia Eau la réalisation de diagnostic Investig’+ , en cours chez des propriétaires volontaires.
La direction du développement de Veolia Eau annonce l’objectif de réaliser 60 000 diagnostics d’installation par an.
Développer l’offre de service sur le marché des PIA
Les dispositifs d’ANC les plus courants sont répertoriés dans la norme européenne EN 12566. Depuis les 3 arrêtés du 7 septembre 2009 (JO du 9 octobre), de nouvelles technologies ont été validées par un avis technique, d’autres sont en cours d’expérimentation en vue du marquage européen CE.
Le but est de développer des solutions d’assainissement des eaux usées au plus près du point d’émission : les petites installations d’assainissement (PIA) apportent des réponses adaptées, de l’installation individuelle (4 ou 5 équivalents habitants) à l’habitat groupé isolé (hameaux de 150 à 200 équivalents habitants).
Pour tester des matériels de PIA, Veolia Eau a participé à deux études en plateforme de recherche : au CSTB de Nantes, en partenariat avec le Cemagref et trois Agences de l’eau, sur 8 systèmes : filtres à sable, extensif et compact, filtre à végétaux, à zéolithe, technique EcoFlex (bidons de rouleaux de fibre textile et tourbe), bassines ouvertes à boralite et culture fixée immergée ; et à Leipzig (Allemagne) sur 12 produits. Ces tests sur 40 semaines sont réalisés sur des eaux usées volontairement très chargées.
L’ANEM (association nationale des élus de montagne) et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse testent 6 PIA en altitude, sur 2 technologies : copeaux de coco (refuge de La Balme) et culture fixée.
Tarn : 23 dispositifs de PIA en test sur 66 installations privées
L’expérimentation est réalisée sur 5 ans par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et Veolia Eau, sur une opération groupée de réhabilitation en milieu rural par 2 communautés de communes, CORA (Rabastens) et SESCAL, avec la participation de 22 industriels. Dans le cadre du contrat conclu avec chaque propriétaire privé, Veolia Eau avance le financement et l’exploitation d’une PIA, en contrepartie d’un remboursement mensuel de 30 € sur 15 ans. L’Agence de l’eau finance 50 % du montant de chaque réhabilitation, plafonné à 9 000 €. Le dispositif testé est remplacé en cas de dysfonctionnement.
Le choix d’une PIA prend en compte plusieurs paramètres : nature du terrain, habitation, infiltration sur la parcelle ou rejet vers un exutoire…
Les dispositifs testés reposent sur une fosse septique ou un décanteur pour le traitement primaire, en ligne avec un massif filtrant compact, une culture libre immergée (cuve avec bactéries flottantes) ou une culture fixée immergée (cuve avec bactéries sur support plastique).
Ils sont adaptés au traitement des eaux usées domestiques : la concentration de pollution en sortie d’une maison individuelle est le double du niveau constaté en sortie de réseau collectif, avec de fortes variations de charge. Ces PIA représentent un investissement de 5 000 à 15 000 €, plus 100 à 600 € par an d’entretien, pour une durée de vie de 20 à 30 ans. Trois exemples en fonctionnement :
- filière Ecofix® de Premier Tech : sur sol argileux, sans possibilité d’infiltration, une fosse septique précède un massif filtrant compact en copeaux de coco (épaisseur 70 cm), placé sous une surface perforée. L’apport d’eaux usées s’effectue par un auget basculant, une pompe de relevage électrique assure le rejet vers l’exutoire. Coût : environ 5 000 €, plus 300 € pour la pompe, avec 120 € d’entretien annuel (1/2 h) et remplacement du coco après 10 à 15 ans (1 500 €). L’abattement de la pollution est efficace, reste à sécuriser la fermeture des couvercles en plastique ;
- culture immergée sur support fixe Bionest : deux cuves, une pour la décantation primaire ; l’autre à deux compartiments combinant surpresseur, réacteur biologique et clarificateur. La consommation d’électricité du surpresseur est de 60 à 80 €/an. La vidange des boues (entre 18 à 24 mois) coûte 200 € (inclus dans l’abonnement). Le bon fonctionnement est suivi par télétransmission (voir EL n° 948). Les 4 tampons de couvercle sont de simples rondelles de béton sans fixation ;
- massif filtrant à sable planté de roseaux Autoépure : un filtre à sable vertical drainé s’écoule sur 5 m² de filtre horizontal planté. La filtration sur roseaux s’avère peu satisfaisante : le seuil d’écoulement entre les filtres est nivelé, il manque un bourrelet autour du massif pour protéger des eaux de ruissellement, la maigre végétation jaunie n’est guère esthétique. Et Investig’+ mesure un déficit d’oxygène, signe de colmatage du filtre. L’ensemble coûte 12 à 16 000 €, contre 7 000 € pour un filtre à sable.
Les résultats complets sur 66 PIA seront publiés en fin de test (2014).
Petites Installations d’Assainissement, Anne Cauchi et Christian Vignoles, Veolia Eau, Editions TECHNIP, 25 rue Ginoux, 75015 Paris
www.garderes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=148
Anne Lévy-Thibert
non signé le 28 avril 2011 - n°949 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline