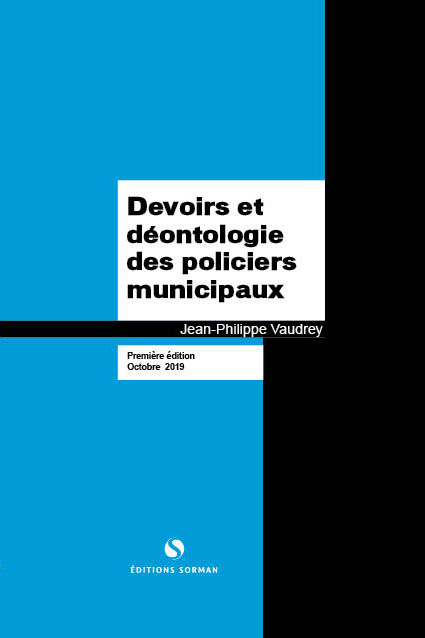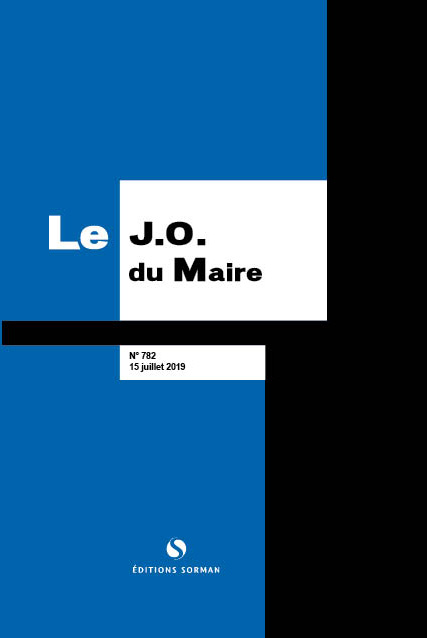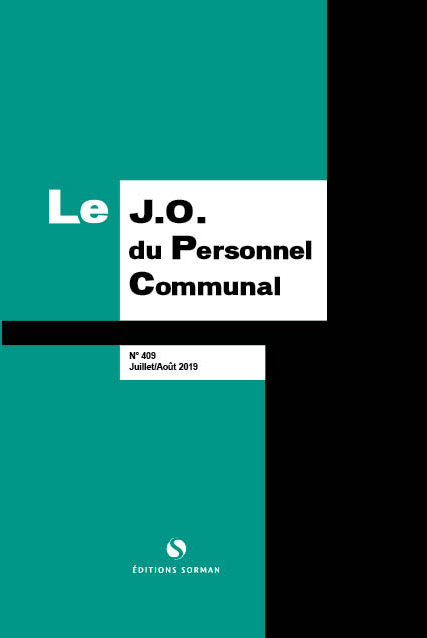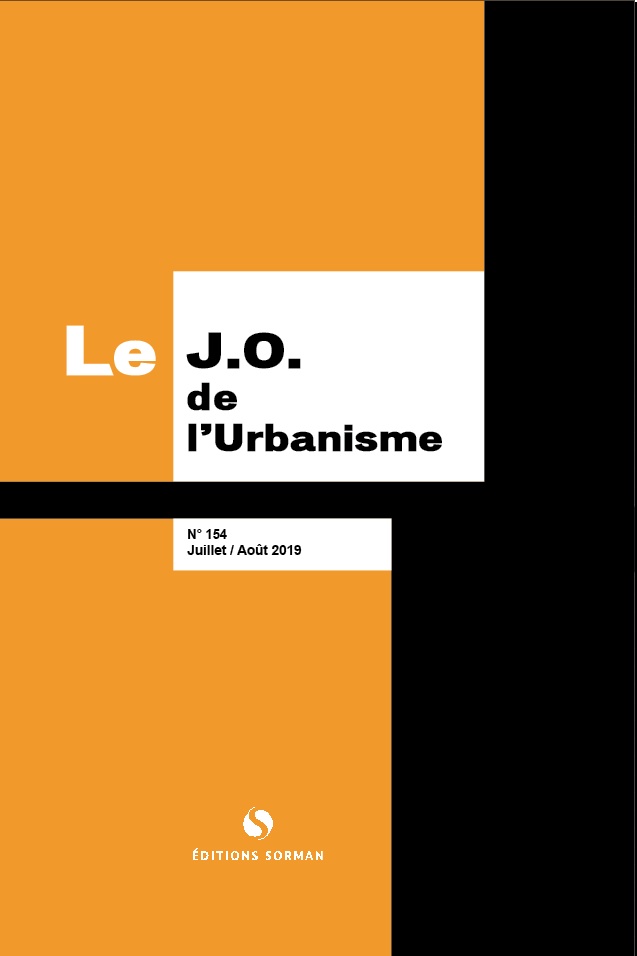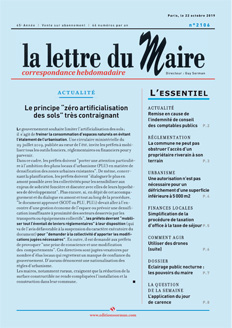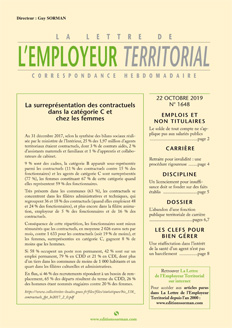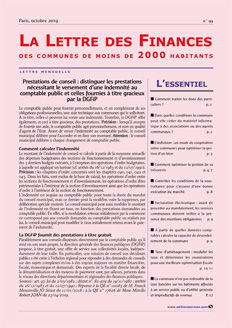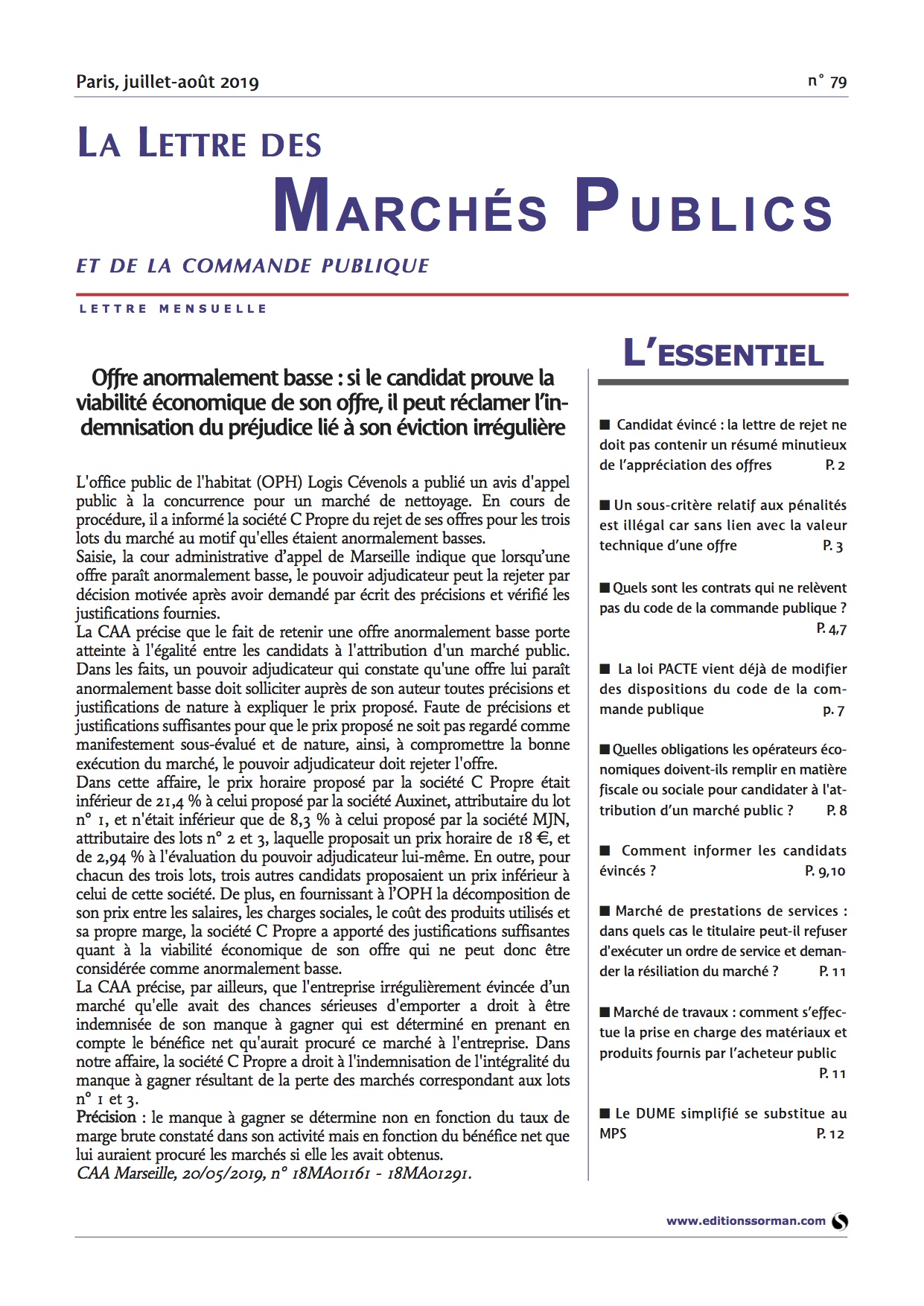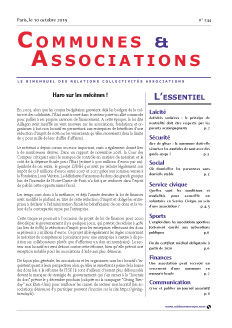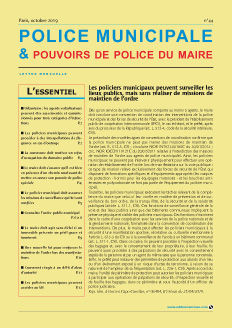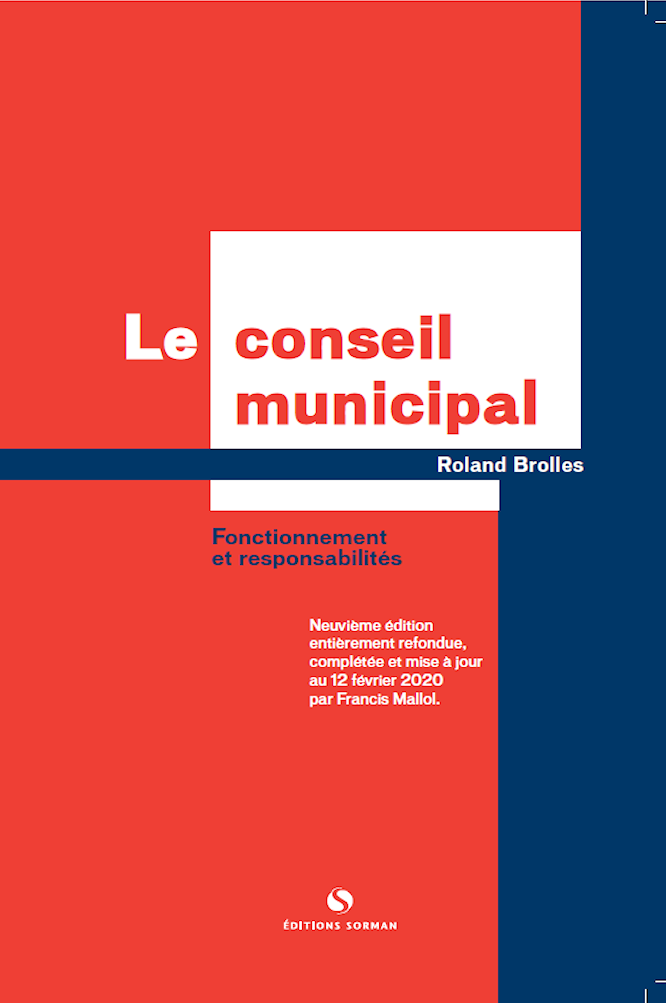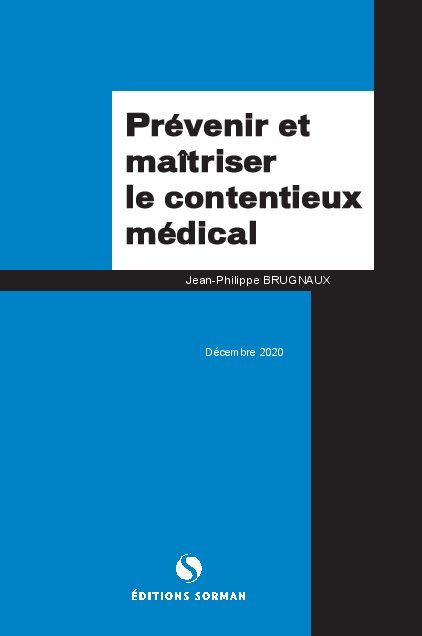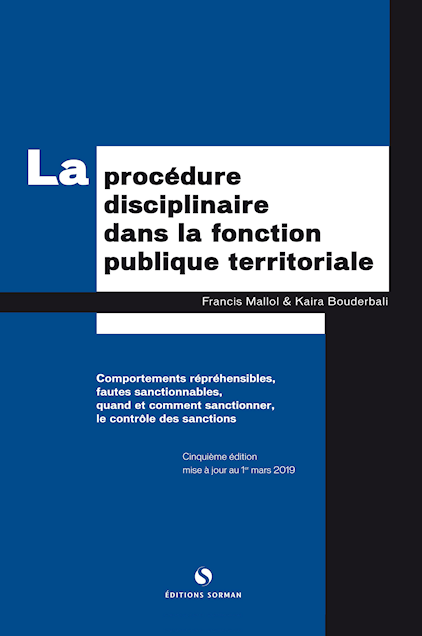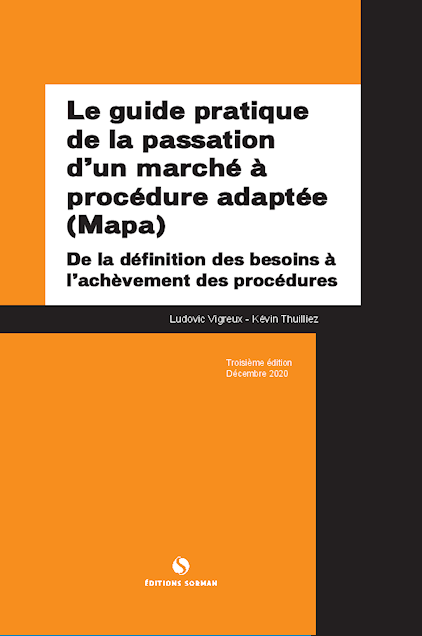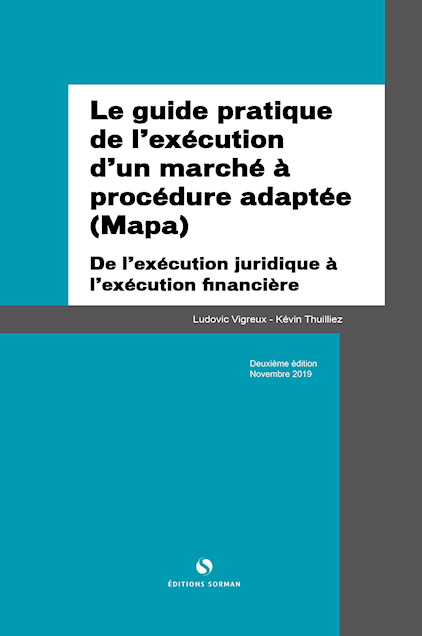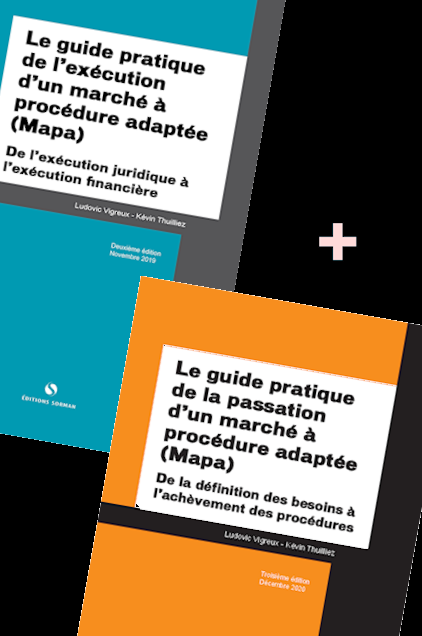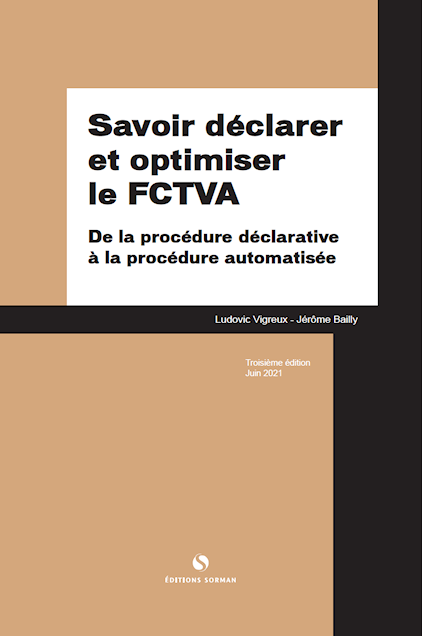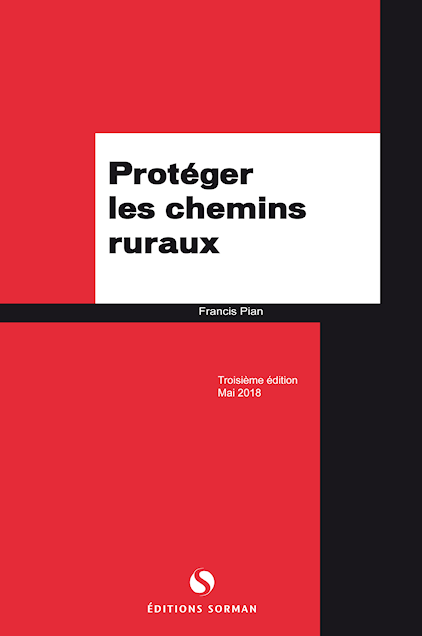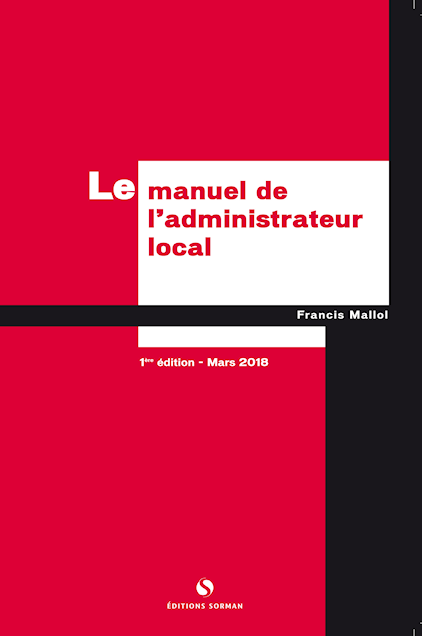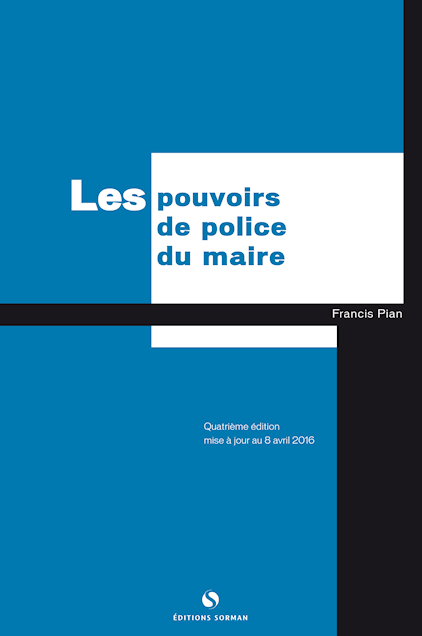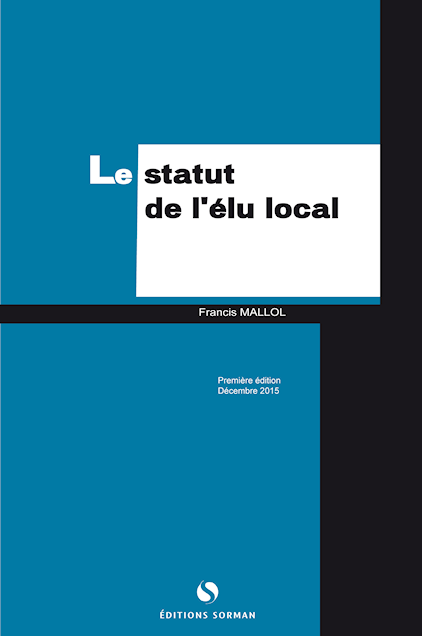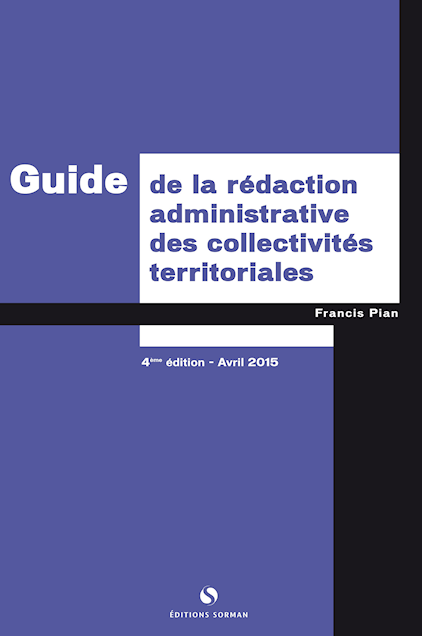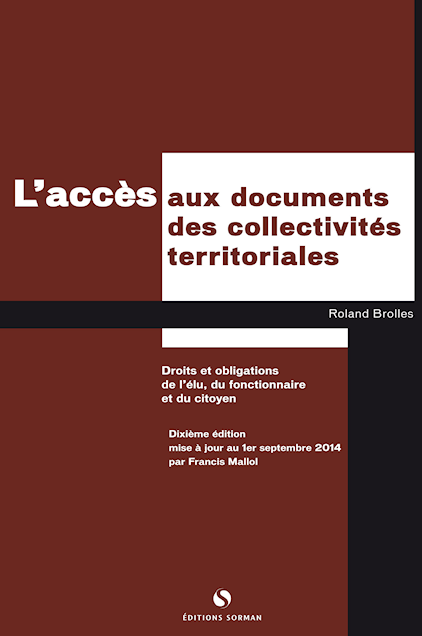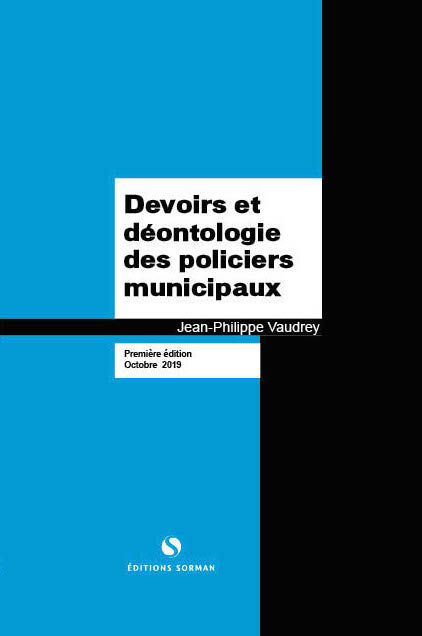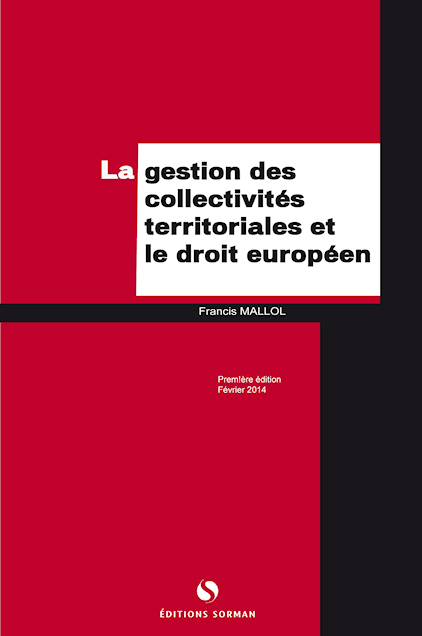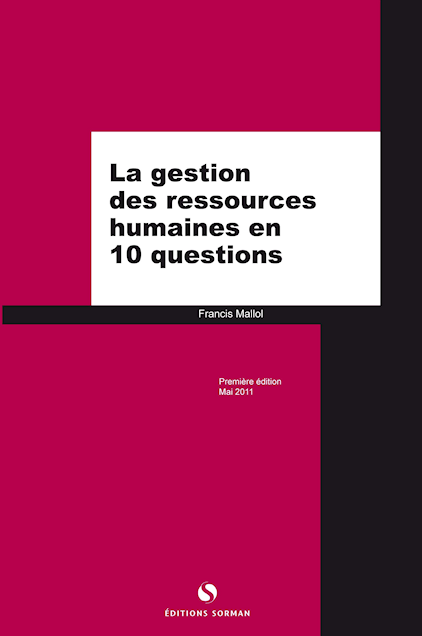Anticiper la réforme du stationnement payant (première partie) Abonnés
Dresser l’état des lieux des usages
Cependant, la future tarification devra être issue d’une réflexion préalable sur la mobilité en ville avec l'objectif de mieux y circuler : quels sont les flux de circulation, les motifs de stationnement, que souhaitent les visiteurs, les résidents, les commerçants ?… Attention à ne pas limiter le champ de l'étude aux seules zones où le stationnement est réglementé pour éviter que les mesures prises en centre-ville n’entraînent un report du stationnement dans d'autres secteurs. Pour dresser cet état des lieux, les collectivités peuvent s'adresser à un bureau d'études spécialisé dans les déplacements, comme à Niort (59 703 habitants) dans les Deux-Sèvres, à une agence d'urbanisme comme à Saint-Omer (14 788 habitants) dans le Pas-de-Calais, ou encore à une université comme à Toulouse (466 219 habitants) en Haute-Garonne.
La commune devra ensuite étudier le taux de paiement spontané dans les différents secteurs où le stationnement est réglementé. En Moselle, Metz (120 708 habitants) est une des villes les plus avancées dans la voie de l'adoption de la nouvelle réglementation. Elle réalise régulièrement des enquêtes sur des échantillons de place de stationnement. Celles-ci lui ont permis de constater que 18 % des usagers ne paient pas et que ceux qui dépassent la durée prévue enfreignent nettement cette limite (aucun dépassement n'est inférieur à 15 mn et 18 % dépassent de plus d'un quart d'heure).
Un équilibre entre les tarifs fixés et le FPS
Pour les communes qui souhaitent favoriser une forte rotation de l'occupation de leurs places de stationnement, la tentation est grande de fixer un FPS d'un montant élevé qui devienne réellement dissuasif. Cependant, le Conseil constitutionnel met en garde : le dispositif ne doit pas s'apparenter à une sanction (puisqu'il ne s'agit plus d'une logique pénale). Le Conseil d’État a précisé ce principe en imposant que le FPS n'excède pas le montant de la redevance d'une journée. Exemple à Tassin-la-Demi-Lune (21 543 habitants) dans le Rhône : en centre-ville le stationnement dans la zone rouge de courte durée est limité à deux heures et coûte 2,5 €. Si la commune conserve ce tarif au 1er janvier 2018, le montant maximal du FPS sera de 2,5 €, soit près de 7 fois inférieur au montant de l'amende actuelle, donc peu dissuasif. En revanche, si la commune augmente le coût horaire de son stationnement, ce dernier deviendra prohibitif au risque de nuire à l'attractivité du centre-ville.
Ajuster sa tarification
La solution consiste à moduler plus finement la grille de tarification avec des variations par demi-heure, voire par quart d'heure. Ainsi, une commune pourra encourager la fréquentation des commerces de centre-ville en fixant une période de gratuité d'une demi-heure par exemple. Puis proposer une tarification faible pour l'heure ou la demi-heure suivante. Ensuite, pour inciter les usagers à libérer rapidement la place qu'ils occupent, la commune pourra faire grimper le tarif du stationnement par quart d'heure. En Haute-Savoie, Annecy (54 087 habitants) propose actuellement un forfait pour le stationnement de courte durée en centre ville : 2 € pour 1h15 (sur une durée totale limitée à deux heures). En 2018, elle envisage de faire payer 5 € chaque quart d'heure supplémentaire. À noter que sur une zone limitée à deux heures de stationnement, un usager qui laissera son véhicule au-delà de cette durée pourra se voir appliquer un FPS autant de fois que cette tranche horaire sera dépassée.
Enfin, la commune sera libre de fixer des montants différents par catégories de véhicules au motif que tous n'occupent pas la même surface : s'il faut 10 m² pour accueillir une voiture, 2 m² suffisent pour une moto. La commune pourra également appliquer un tarif plus favorable aux véhicules les moins polluants.
(Dans notre prochain numéro : Comment organiser le recouvrement du stationnement ?)
Journée du 9 février 2016 co-organisée avec la Mission interministérielle chargée de la décentralisation du stationnement, le Groupement des autorités responsables de transport, France urbaine et l'Assemblée des communautés de France.
Jean-Philippe ARROUET le 25 février 2016 - n°1055 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline