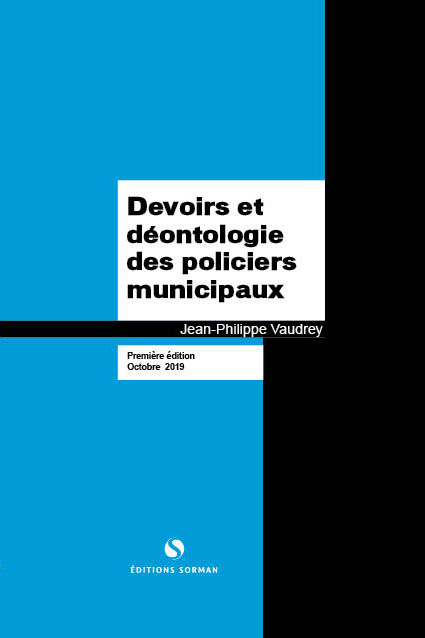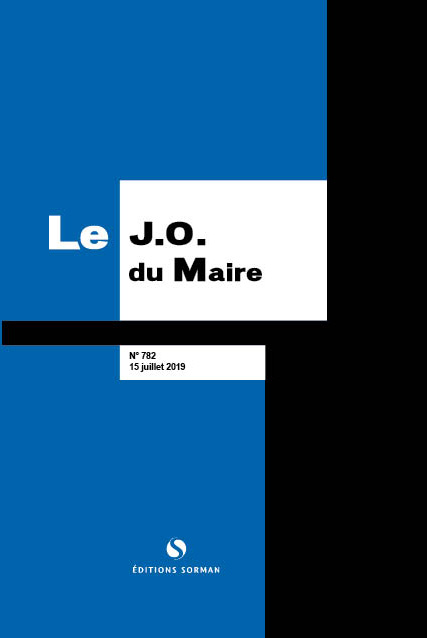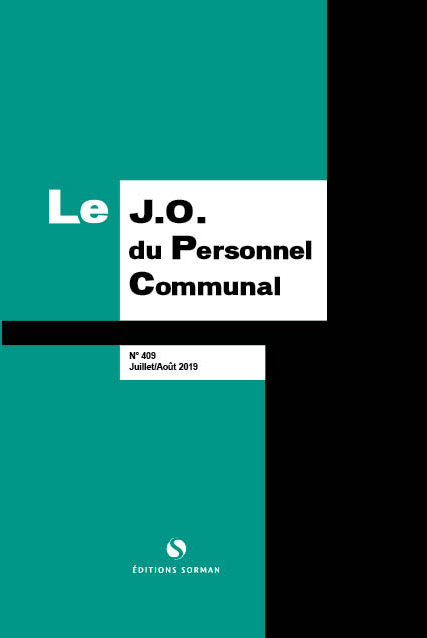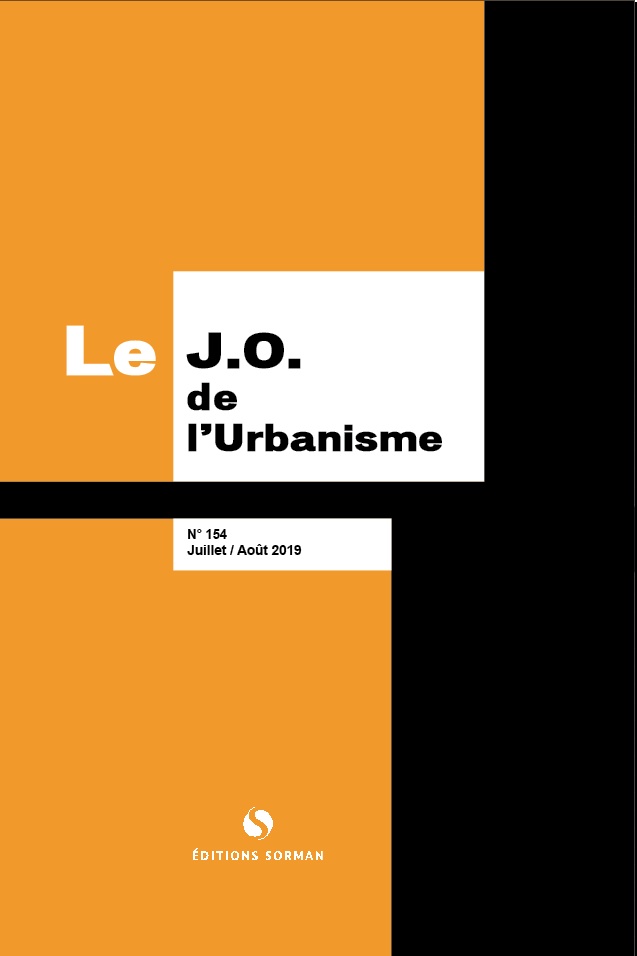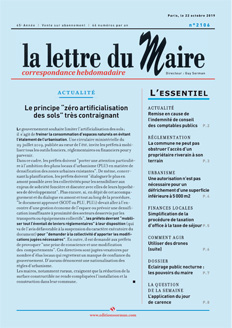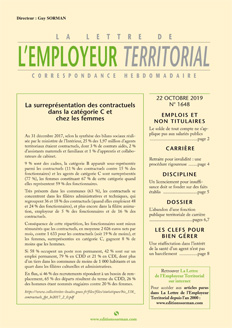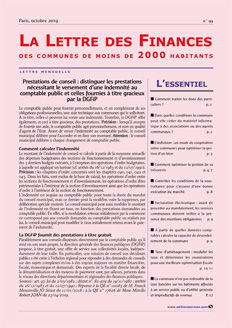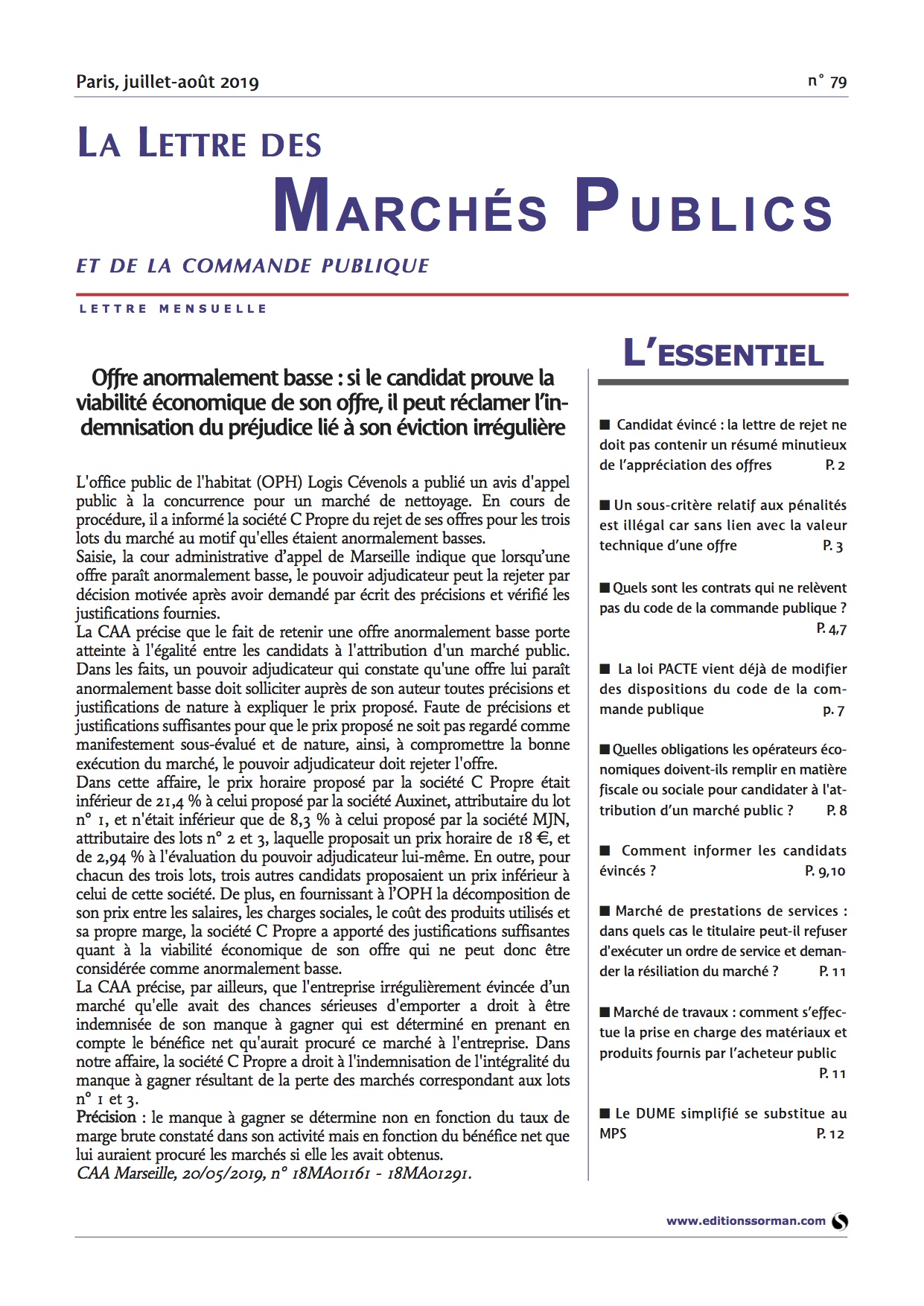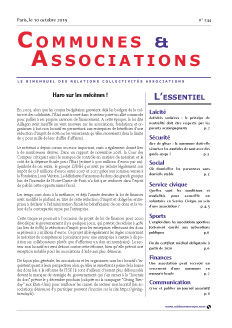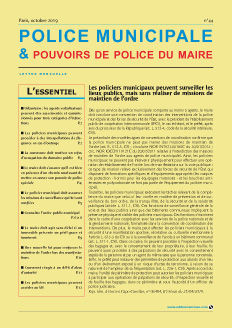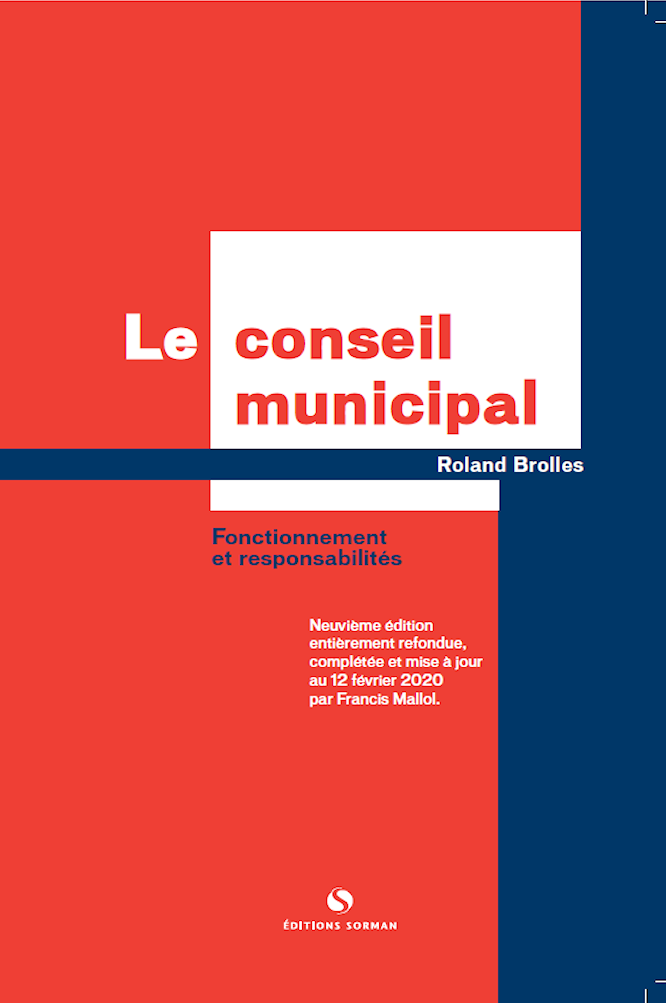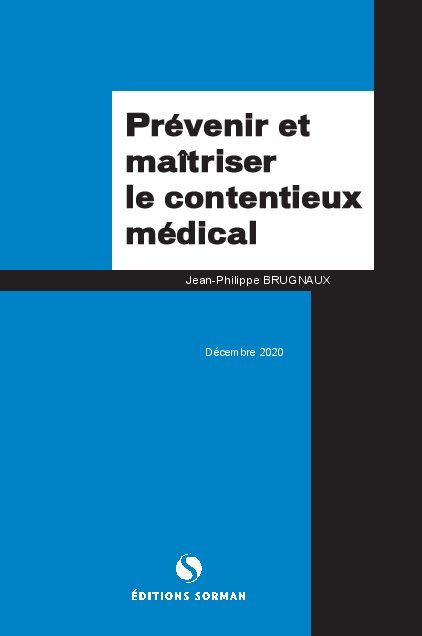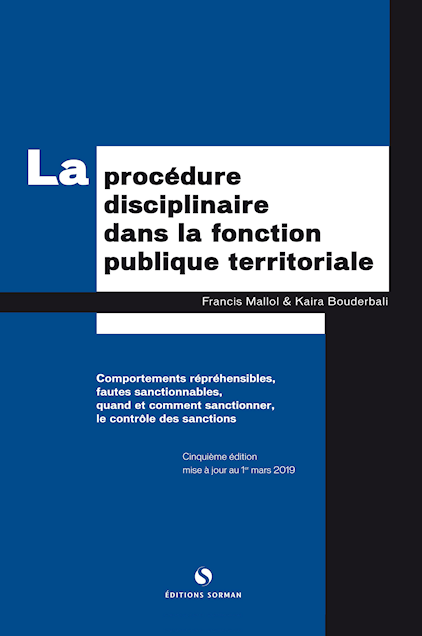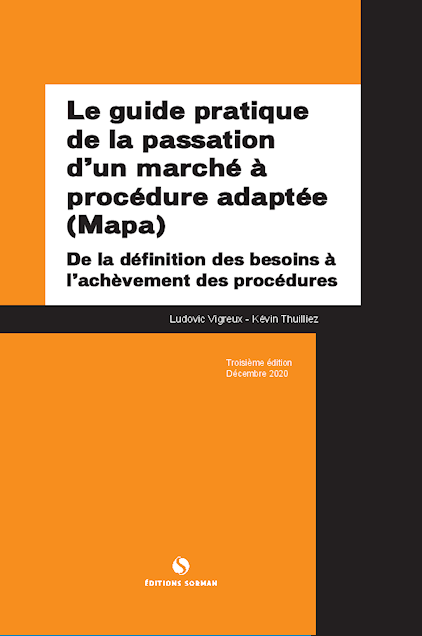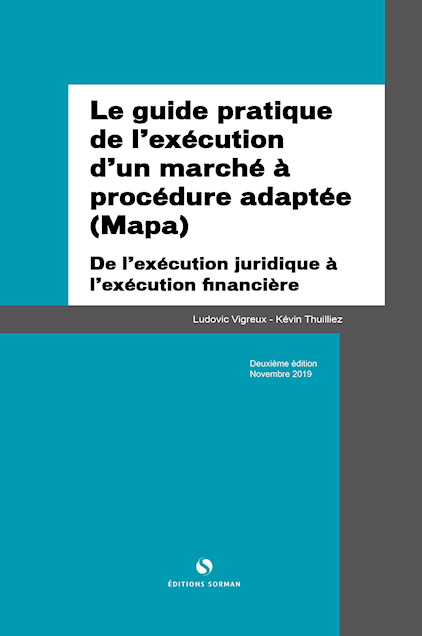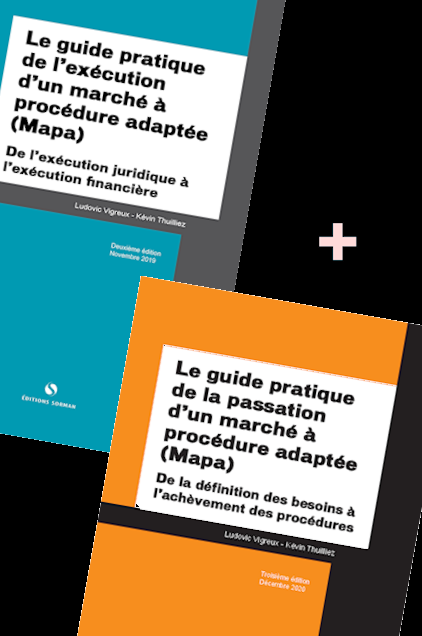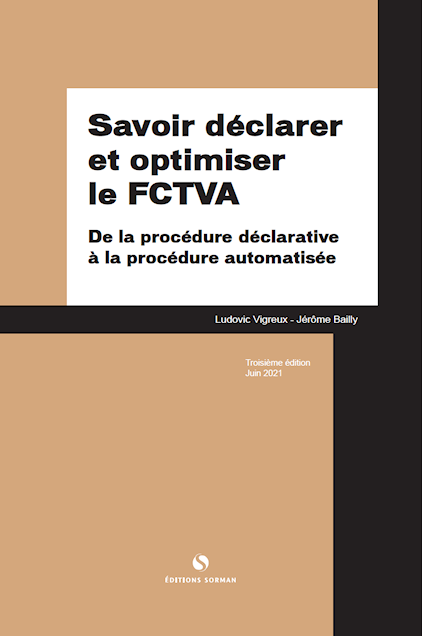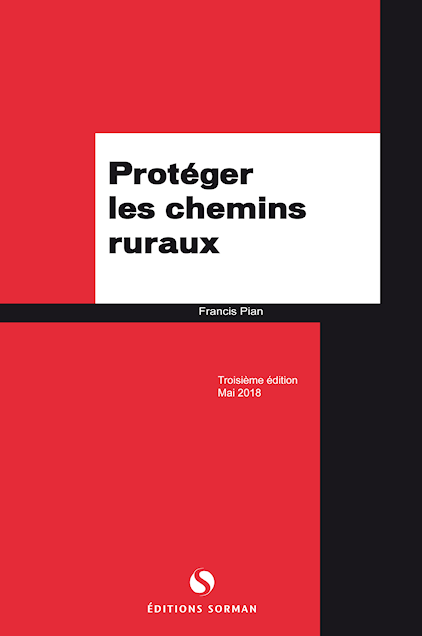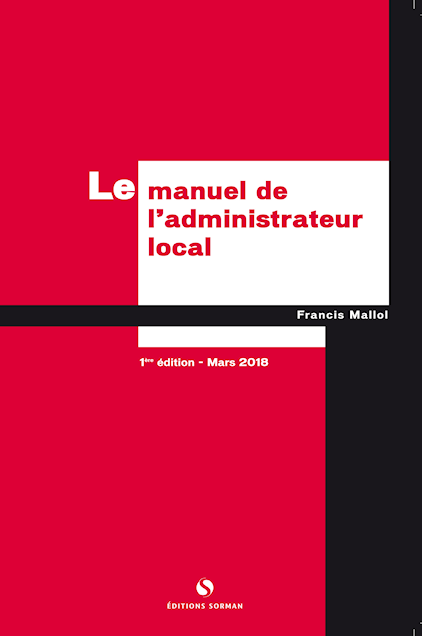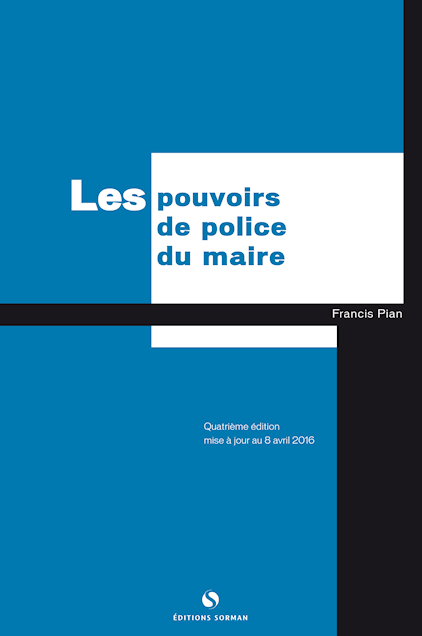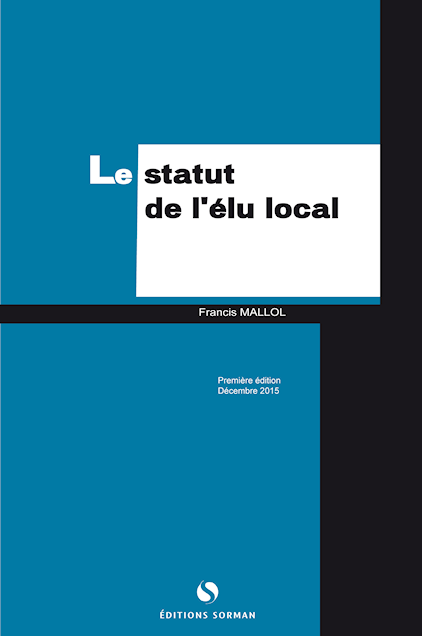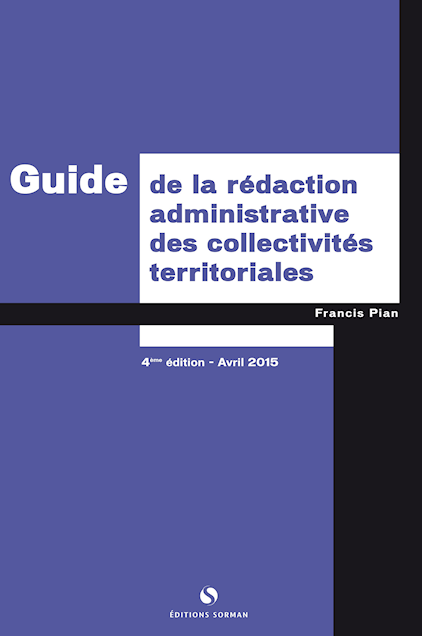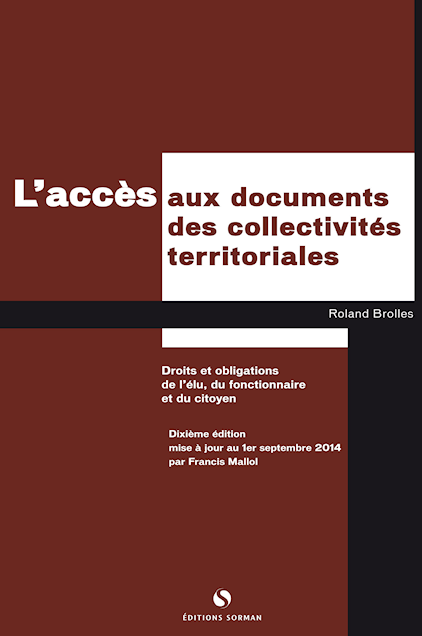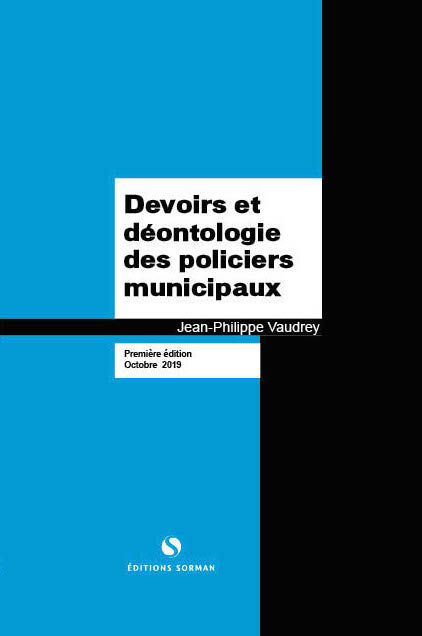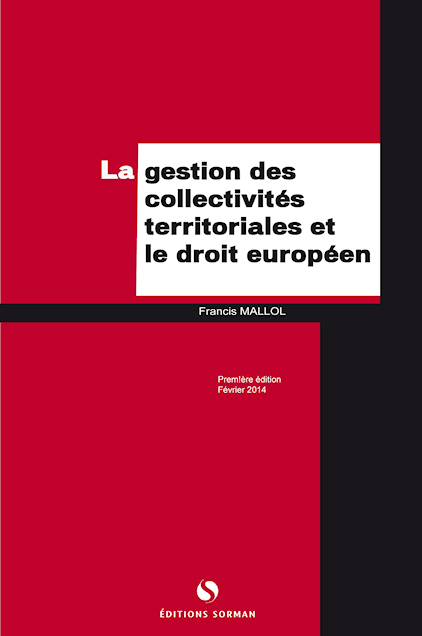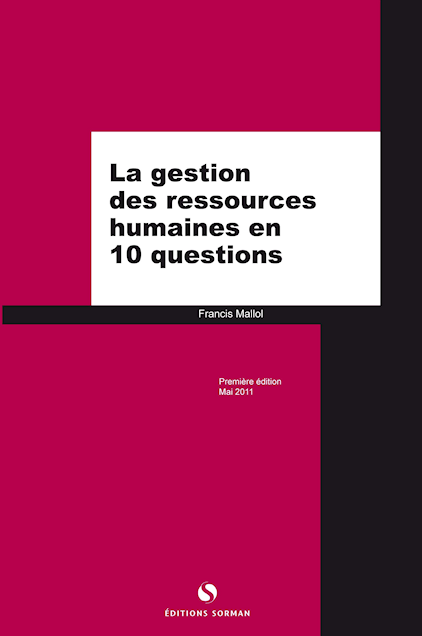Arrosage des espaces verts : comment économiser l’eau Abonnés
Au cours des phases de création et d’aménagement de nouveaux espaces végétalisés, une réflexion préventive à la consommation en eau permettra de limiter les besoins nécessaires au développement des végétaux et d’économiser à court terme la ressource. Six actions peuvent être aisément mises en place, depuis la phase de conception des espaces verts jusqu’à la phase de gestion : la sélection de végétaux tolérants aux conditions sèches, un fleurissement privilégiant les plantes vivaces, l’utilisation de plantes couvre sol pour préserver les sols nus et lutter contre une évaporation importante, la sélection de végétaux adaptés à la nature du sol, l’implantation d’espèces locales et la plantation d’associations de différentes variétés de végétaux.
Une gestion optimisée de l’arrosage
Pour préserver la ressource en eau, des techniques de gestion optimisée de l’arrosage sont à privilégier par le service des espaces verts : le paillage systématique des parterres, une gestion différenciée sur les espaces moins fréquentés, le développement et la préservation de refuges pour la biodiversité et une plus grande diversité de paysages sur les sols fragiles ou écologiquement précieux, la sensibilisation et la formation des agents à la préservation de la ressource, la détection des fuites sur le réseau d’arrosage, un arrosage nocturne quand l’évaporation est réduite, une plantation privilégiée à l’automne, l’apport de matière organique augmentant la capacité de rétention en eau du sol, une fertilisation raisonnée pour maîtriser les tontes, les tailles et les élagages, la réduction du nombre de plantes annuelles, le désherbage par binage, le développement des cuvettes d’arrosage pour les arbres d’alignement récemment plantés.
Un plan d’arrosage des espaces verts
Pour une gestion optimisée des aménagements et la réduction de la consommation en eau, la collectivité devra définir un plan d’actions répondant aux besoins des végétaux : formation des agents aux économies d’eau (méthodes et pratiques d’arrosage raisonné, conception, réglage et maintenance des systèmes d’arrosage...), analyse des caractéristiques physico-chimiques du sol pour y pratiquer un arrosage de précision (compter 150 € pour une étude de sol simple et jusqu’à 2500 € pour une analyse approfondie, ces frais étant amortis à court terme au regard des économies d’eau engendrées au prix moyen de 1,8 €/m3). Au-delà de l’expérience des agents et de l’utilisation de données météorologiques locales pour établir un diagnostic des besoins en eau, il est conseillé d’établir le bilan hydrique des sols soumis au système d’arrosage automatique pour en connaitre la réserve en eau et apporter la bonne quantité au bon moment.
On veillera à adapter la méthode d’arrosage aux types de végétaux (système d’aspersion pour les terrains sportifs, les gazons d’agrément ou les massifs floraux, goutte à goutte sur les massifs arbustifs, arrosage manuel ciblé pour les gros sujets ou les jeunes plants...), à réaliser une maintenance régulière du système d’arrosage automatique afin de s’assurer de l’efficacité de l’arrosage et de limiter les pertes potentielles en eau dues à des dysfonctionnements ou à des actes de vandalisme (orientation des asperseurs, débit des buses, homogénéité de la pluviométrie...), puis à rénover, si besoin, un réseau d’irrigation vétuste qui subit des fuites.
Conseil : privilégier l’installation d’un système d’arrosage par goutte à goutte enterré plutôt par aspersion, davantage exposé au vandalisme (surcoût de l’installation de 35 % mais rentabilité à court terme grâce à la diminution des coûts de réparation).
Dans un souci d’économies, les collectivités peuvent également développer une gestion centralisée de l’arrosage automatique sur la base d’une formation à l’utilisation (arrosage de précision et contrôle des fuites du réseau) afin de diminuer les déplacements des agents ; elles peuvent également rationaliser le fonctionnement des bassins et des fontaines pour maîtriser la consommation et privilégier un fonctionnement en circuit fermé s’appuyant sur une source alternative à l’eau potable en développant des dispositifs de récupération des eaux pluviales ou en recyclant les eaux de piscine.
Enfin, il est recommandé d’organiser le management de la compétence en eau au sein des services afin de suivre, de centraliser et de partager le suivi régulier des consommations et des actions, de la maintenance aux différentes utilisations de la ressource.
À retenir : des financements partiels sont proposés par les agences de l’eau, selon la nature du projet envisagé par la collectivité (études, travaux neufs ou sur l’existant).
(Voir aussi article Assainissement page 8 : « La bonne utilisation des eaux usées traitées »).
Marie Brévière le 09 juin 2016 - n°1062 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline