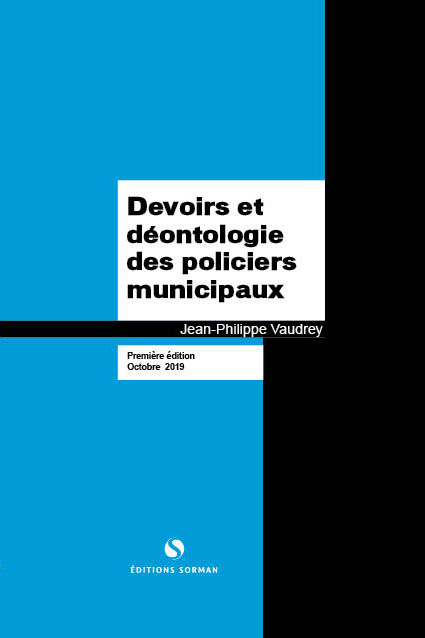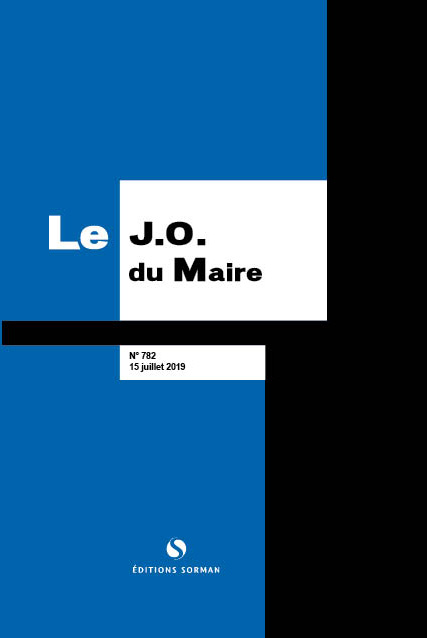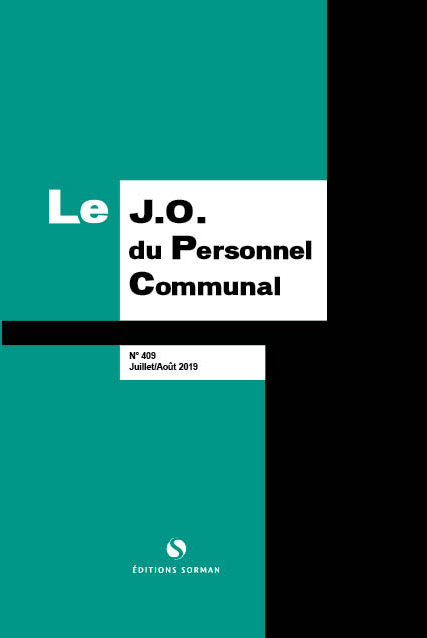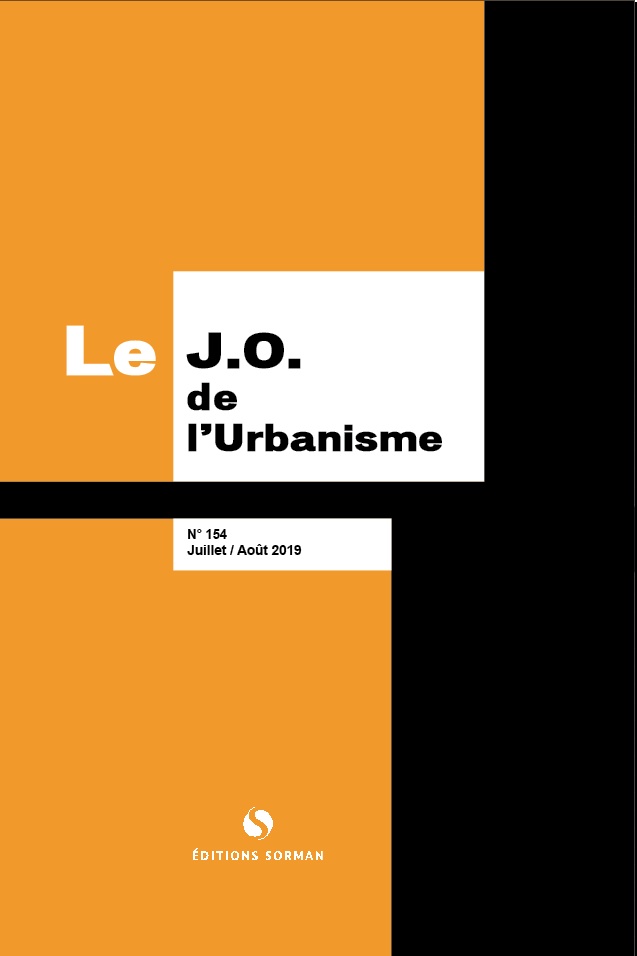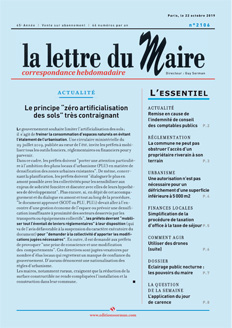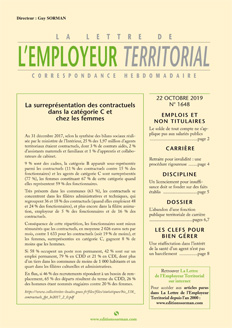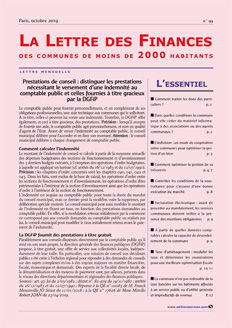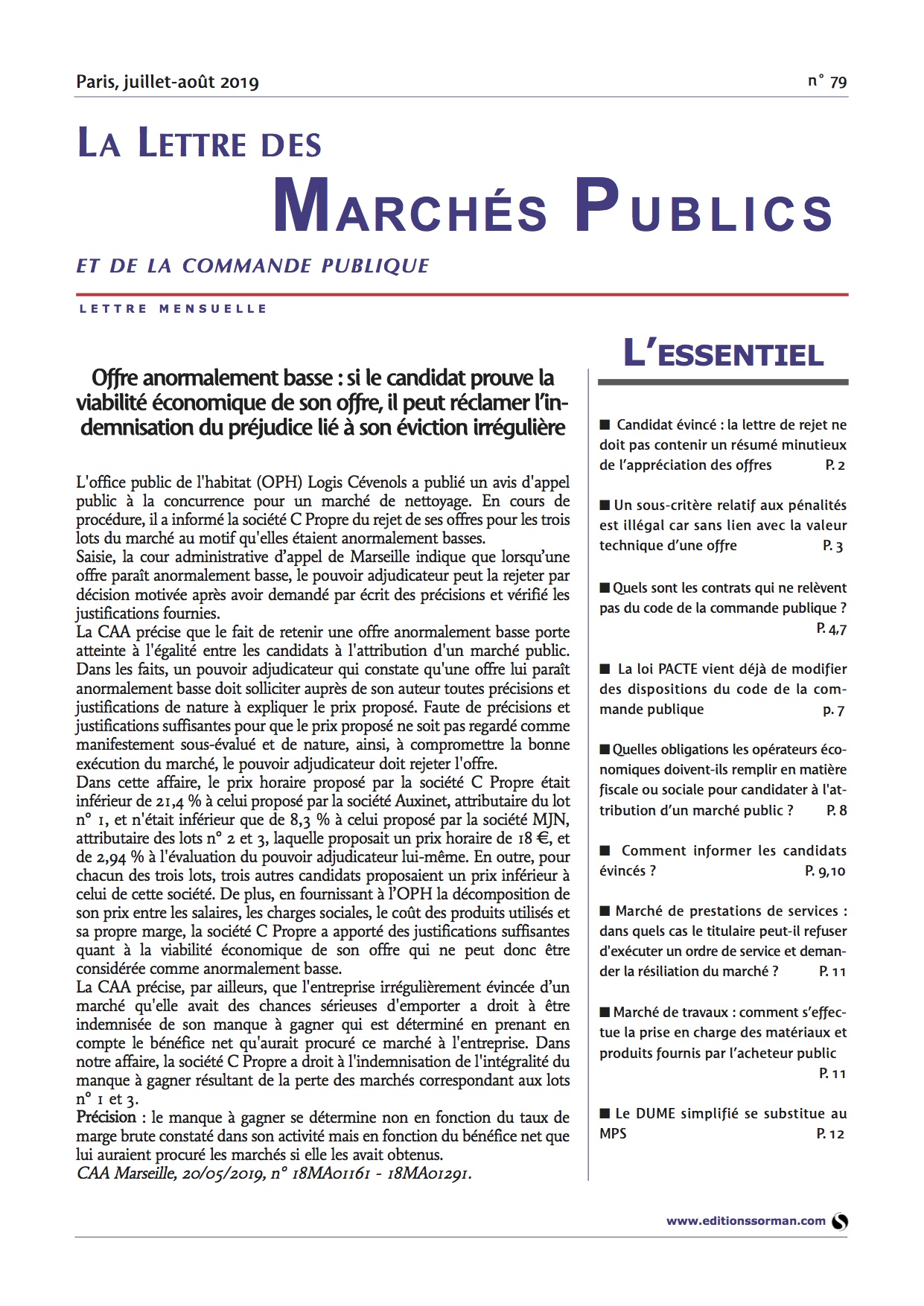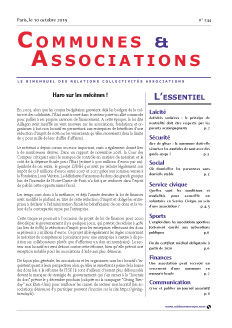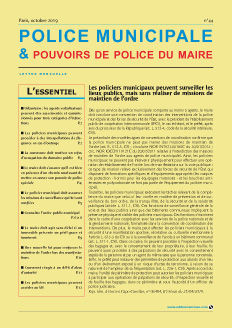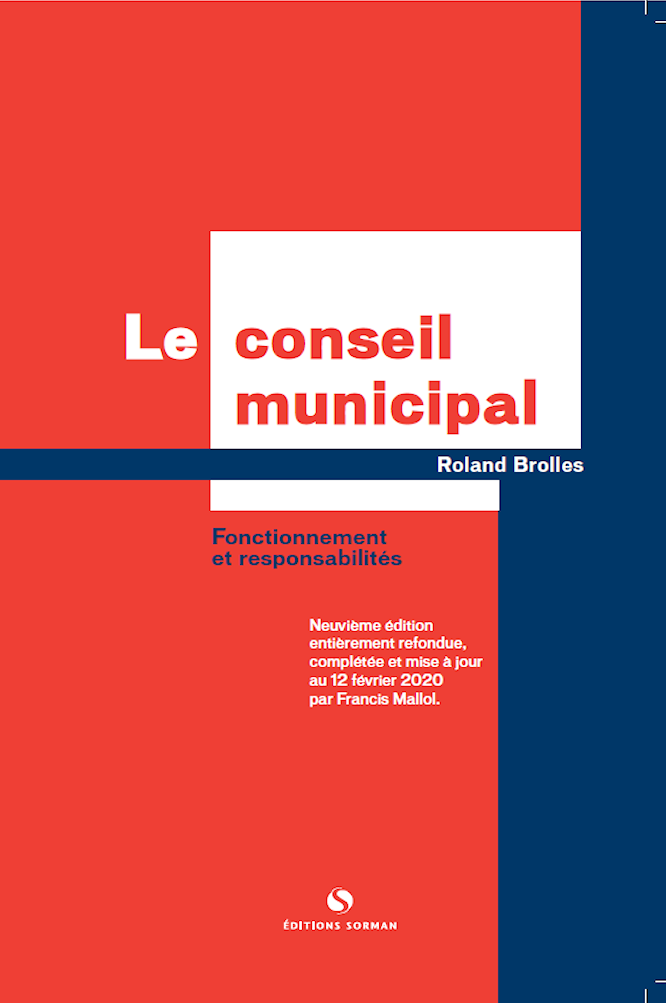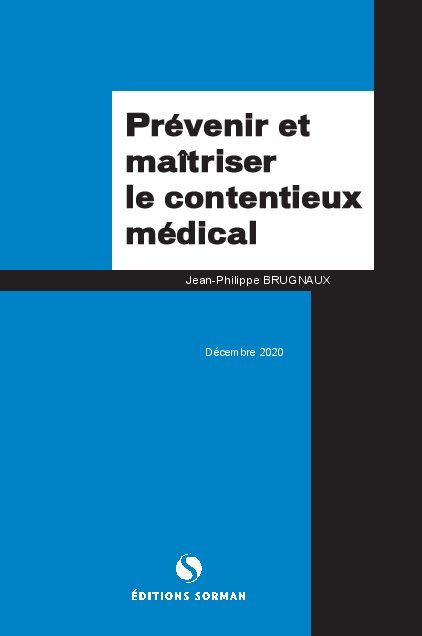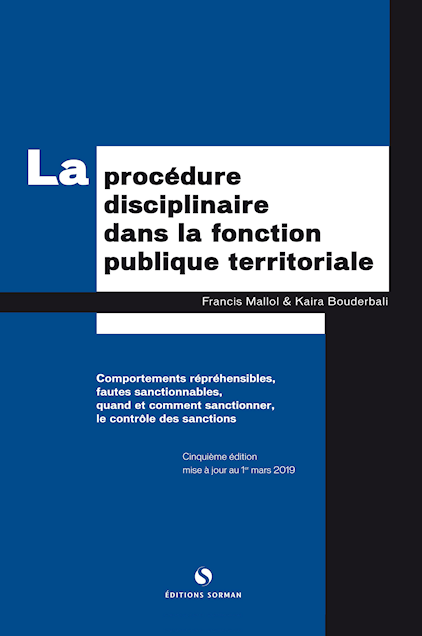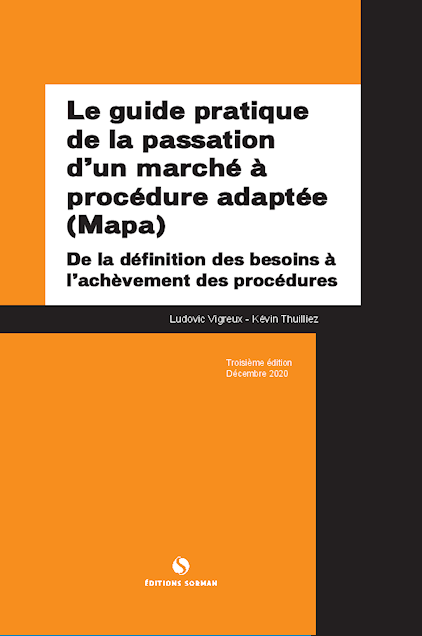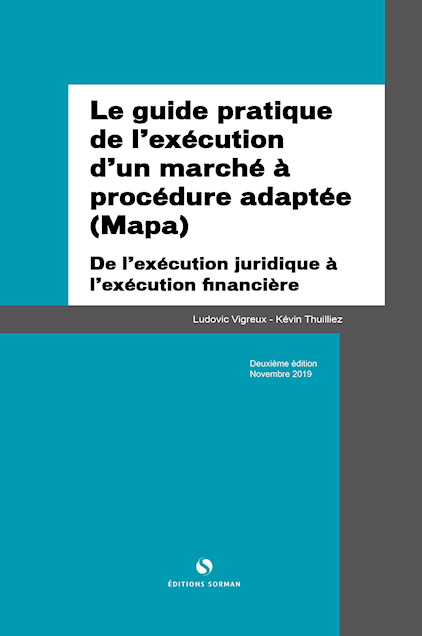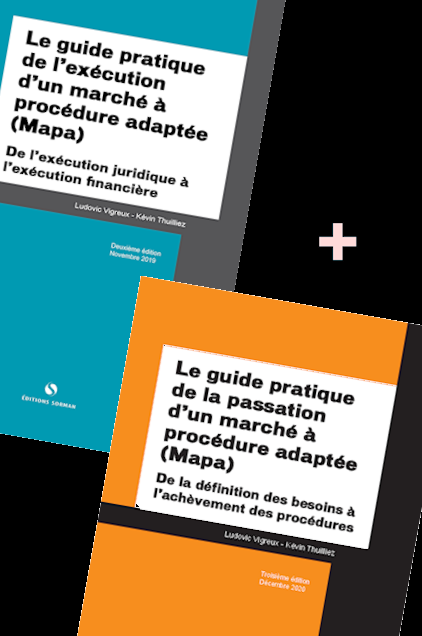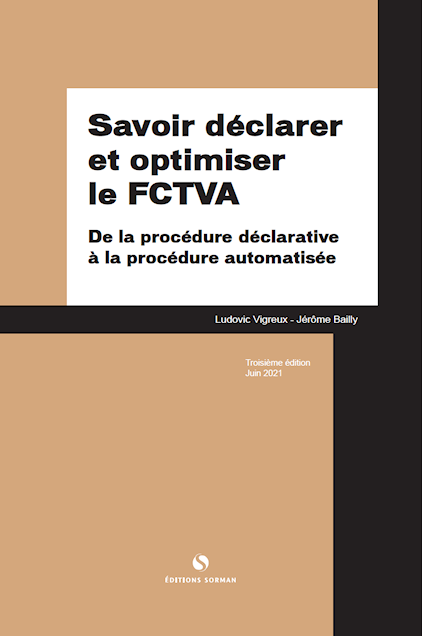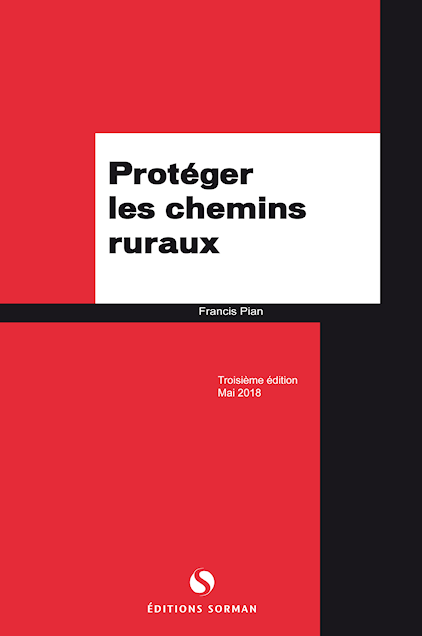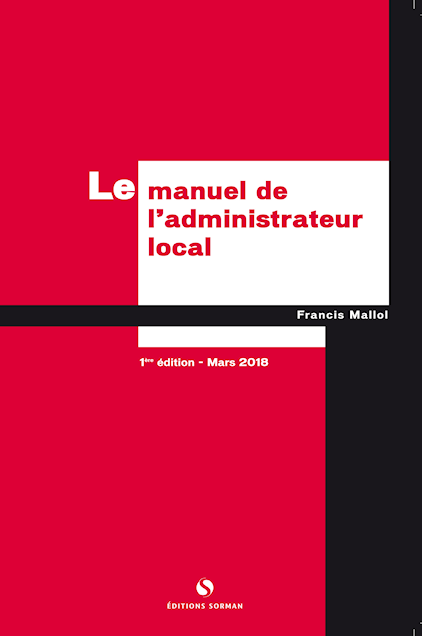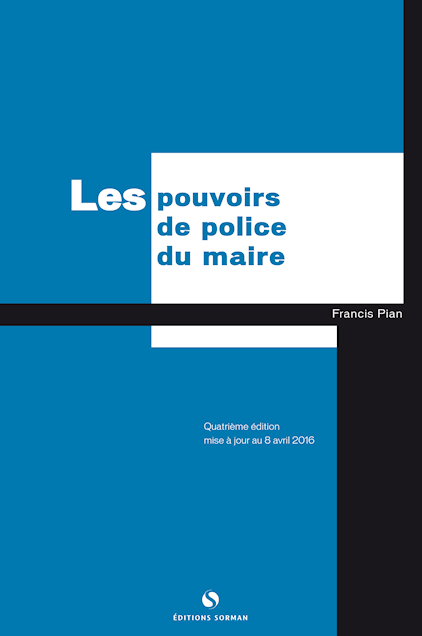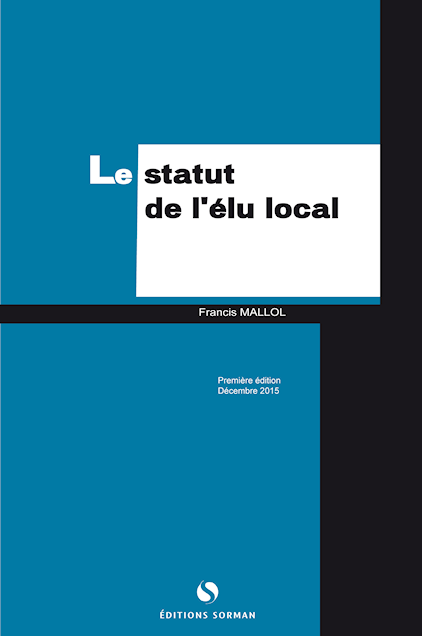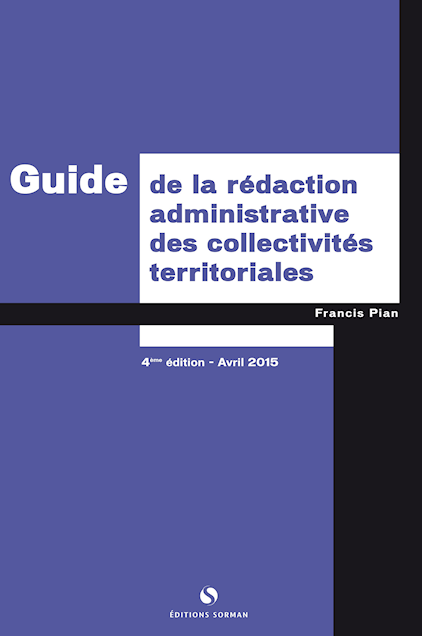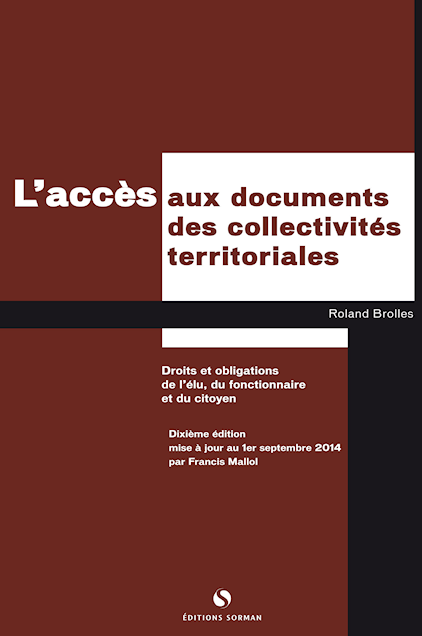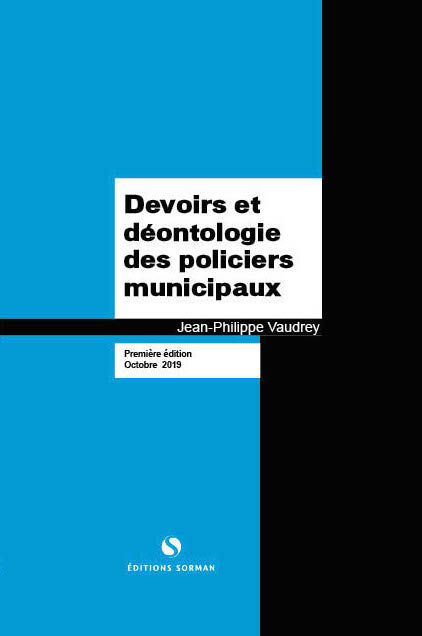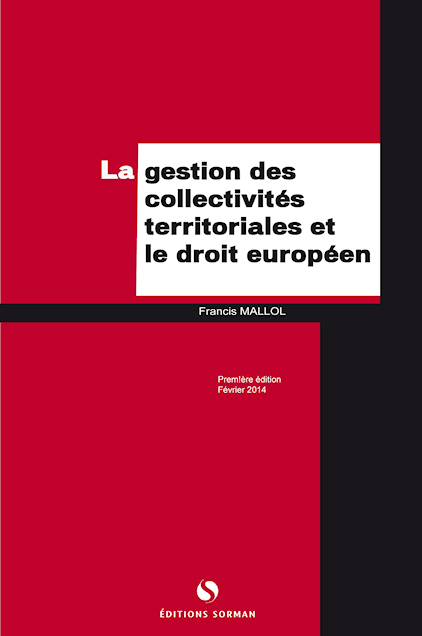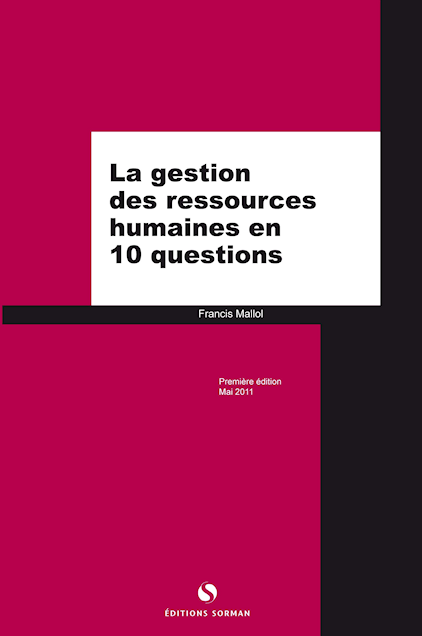Éclairage public : compétences et responsabilité des communes Abonnés
Une responsabilité étendue au-delà de la voirie
Cette compétence ne se limite pas au domaine communal. Elle inclut toutes les voies ouvertes à la circulation (article L. 2213-1 du CGCT), y compris les voies privées et les routes départementales, ainsi que l'a précisé la jurisprudence (CAA de Douai, 18 mai 2004). Jean Facon, directeur adjoint de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), rappelle que l'éclairage public ne se limite pas non plus à la voirie. Le code de l'environnement (article R. 583-2), qui impose à la commune de limiter les nuisances lumineuses et la consommation d'énergie, cite l'éclairage de mise en valeur du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ; celui des équipements sportifs de plein air ou découvrables ; celui des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ; l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts ; l'éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ; celui des chantiers en extérieur.
Une compétence transférable totalement ou partiellement
La commune conserve la possibilité de transférer la compétence éclairage public à un syndicat d'énergie ou à une intercommunalité. Dans ce dernier cas, le transfert de l'éclairage public n'est pas lié à celui de la compétence voirie. Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 juin 1993 a en effet rappelé que « si les compétences de la commune de Lormont en matière de voirie ont été transférées à la Communauté Urbaine de Bordeaux, conformément à l'article L. 165-7 du code des communes, il n'en va pas de même en matière d'éclairage public, lequel est ici mis en cause indépendamment de la voie publique ».
Par ailleurs, en cas de transfert de la compétence éclairage public, les communes peuvent choisir « de conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires » (article L. 1321-2 du CGCT). Dans les Côtes-d'Armor, la totalité des 33 EPCI et 363 communes sur 373 adhérentes au syndicat départemental d'énergie (SDE 22) ont choisi de lui transférer également la maintenance de leur éclairage public. La logique est moins juridique qu'économique puisque le syndicat, devenu maître d'ouvrage, passe un marché à bons de commande d'une durée de quatre ans pour la maintenance de la totalité des 110 000 foyers lumineux. Il prévoit que les entreprises interviennent une fois par an sur chaque candélabre. Le coût par foyer lumineux s'établit à 25,70 € par an sur lesquels 10,40 € sont pris en charge par le SDE22. Le coût annuel à la charge des communes et des EPCI adhérents est donc réduit (15,30 € par foyer lumineux).
Éclairer en conciliant économies et sécurité
En cas d'accident sur la voie publique mettant en cause l'éclairage public, la responsabilité du maire sera recherchée au titre de son pouvoir de police même si la compétence éclairage publique a été transférée. Toutefois, la jurisprudence explicite qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute dès lors que le maire démontre que l'insuffisance ou le défaut d'éclairage incombait au syndicat d'énergie ou à l'EPCI compétent. À cet égard, le maire soucieux d'économiser l'énergie doit également veiller à la sécurité en maintenant l'éclairage public notamment aux points les plus dangereux. Une récente réponse ministérielle (à la question écrite n° 14883 du sénateur Claude Raynal publiée au JO du 01/10/2015) clarifie pour la première fois les bonnes pratique en rappelant que « l'éclairage public ne saurait être supprimé sur l'ensemble du territoire de la commune. Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d'éclairage public au regard des circonstances locales. Dès lors qu'il serait ainsi en mesure de démontrer qu'il a accompli toutes diligences, le maire ne devrait pas voir sa responsabilité reconnue. »
Jean-Philippe ARROUET le 05 novembre 2015 - n°1048 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline