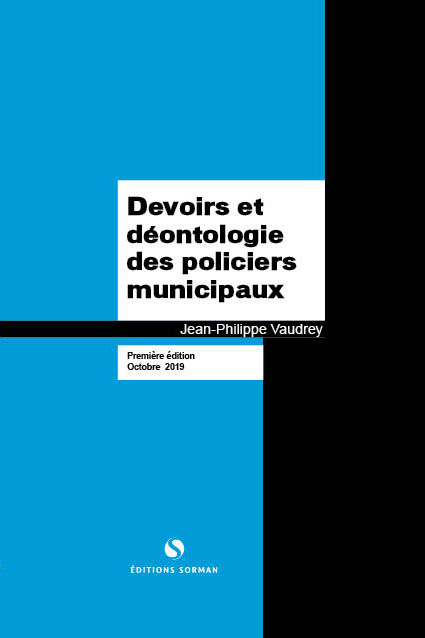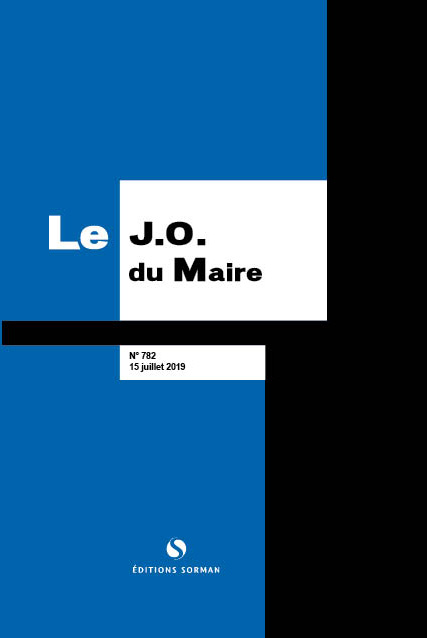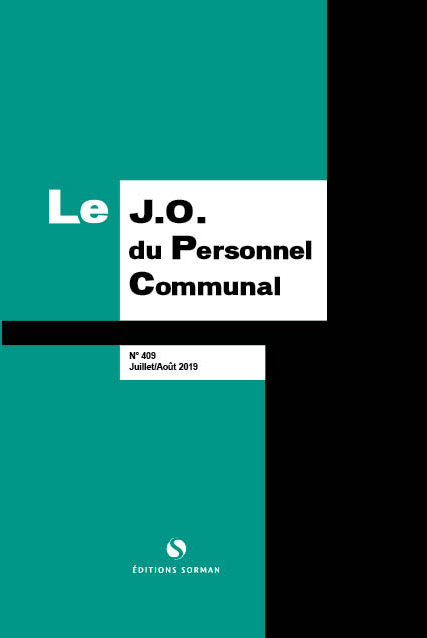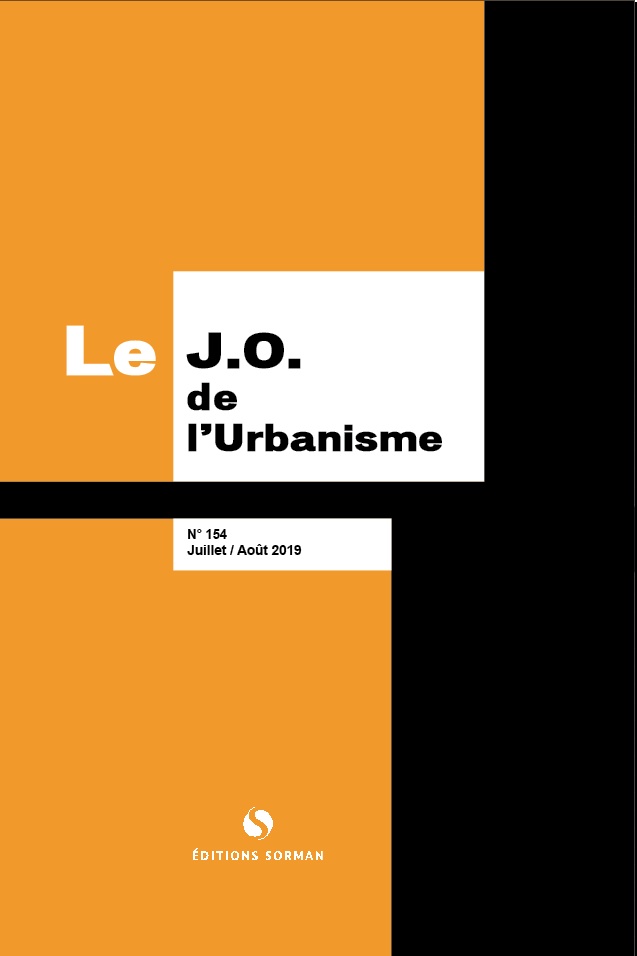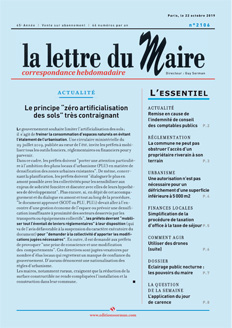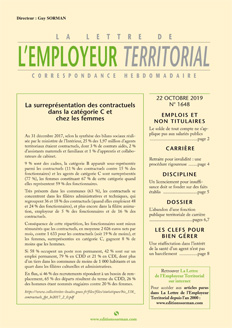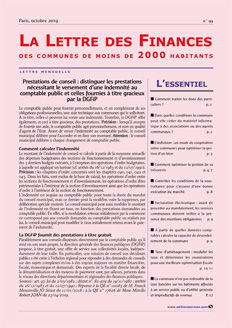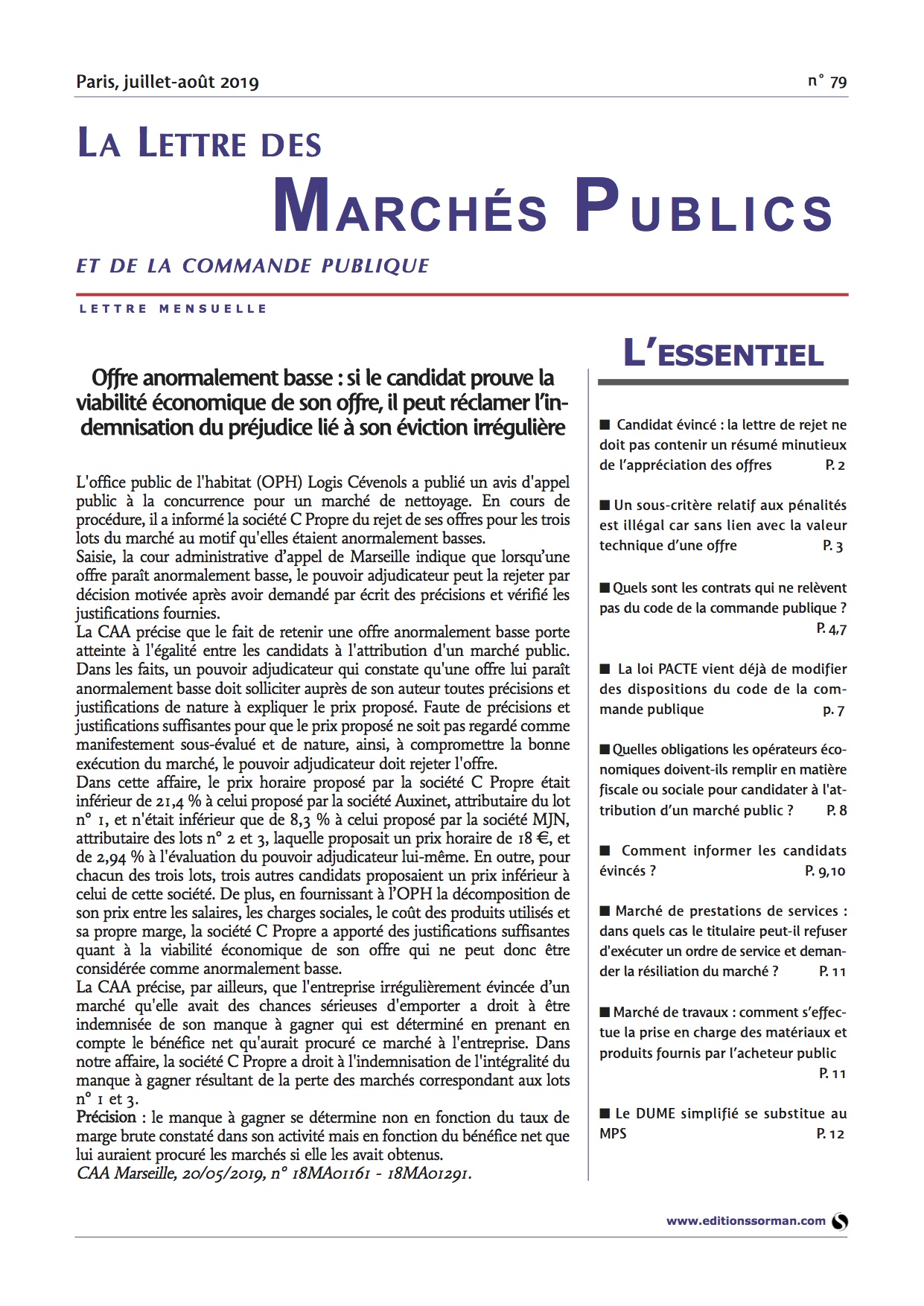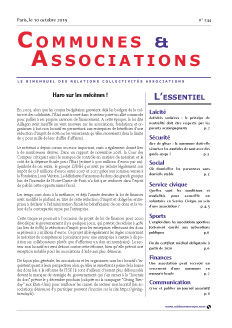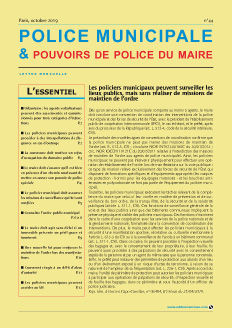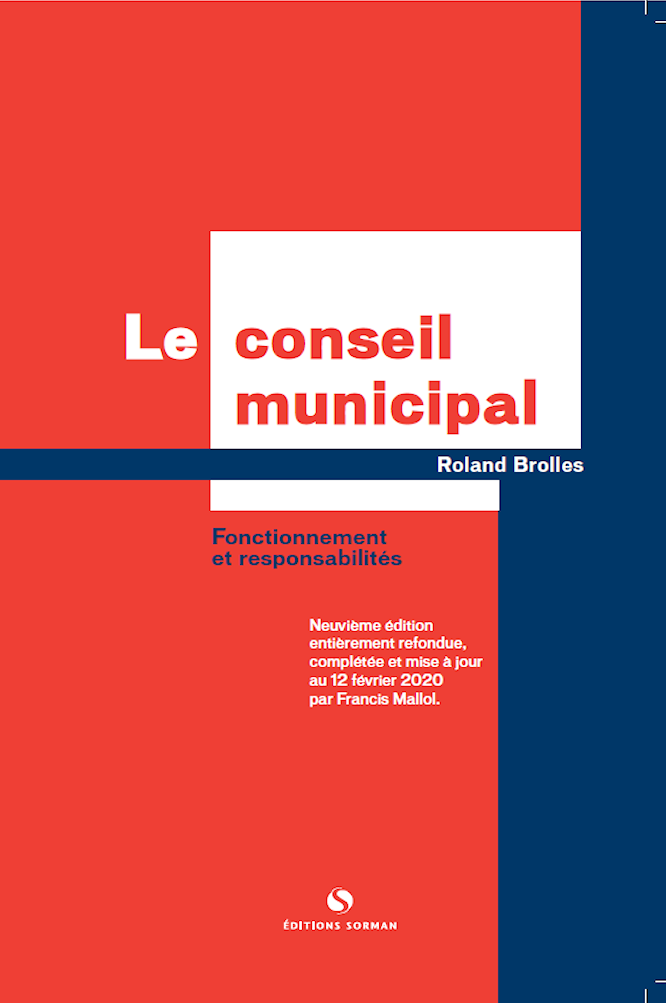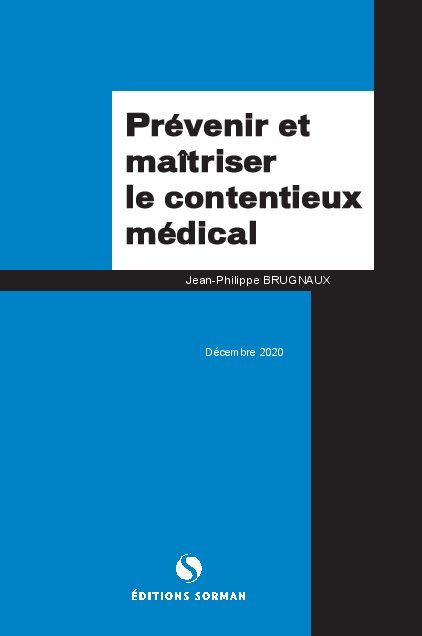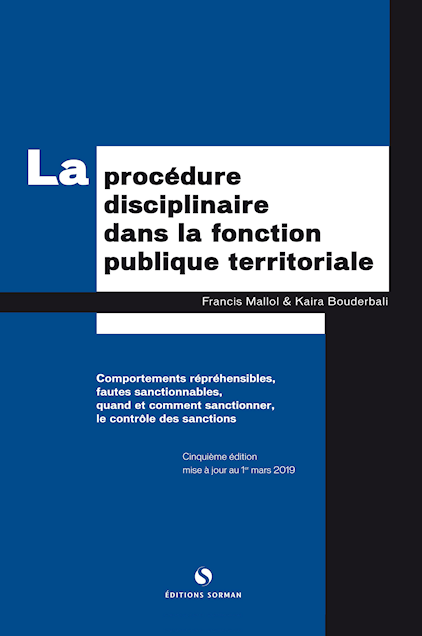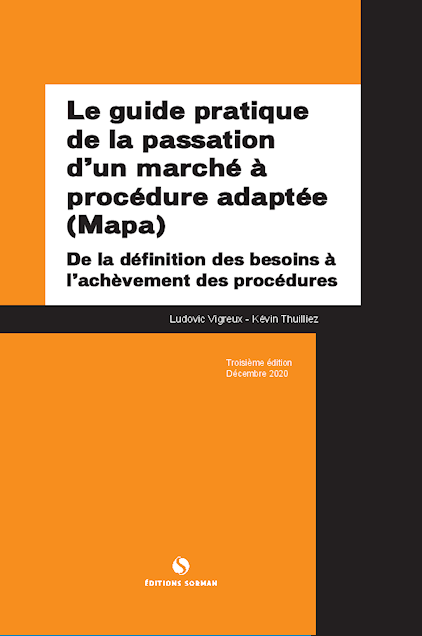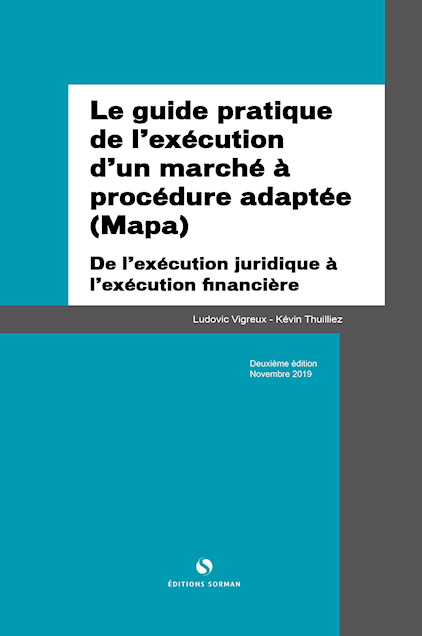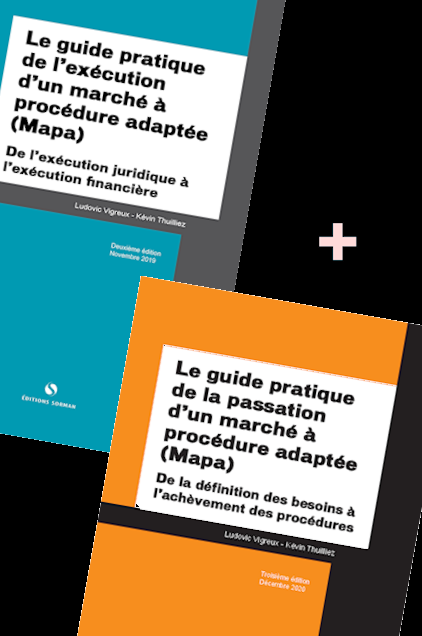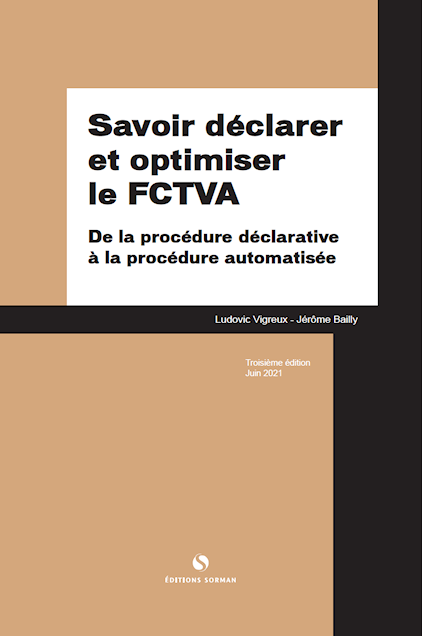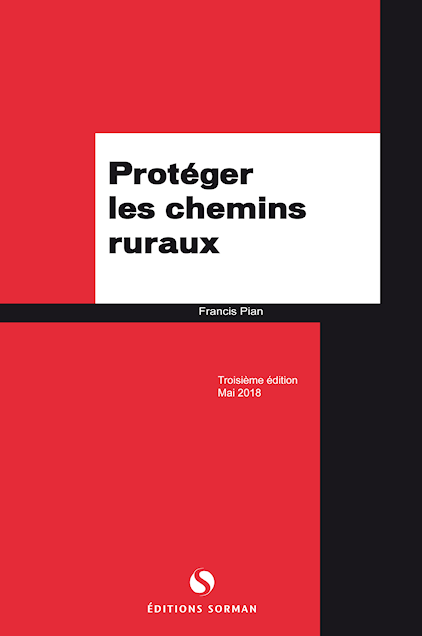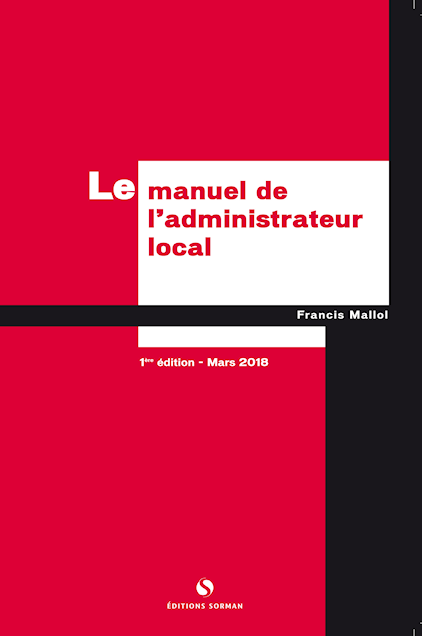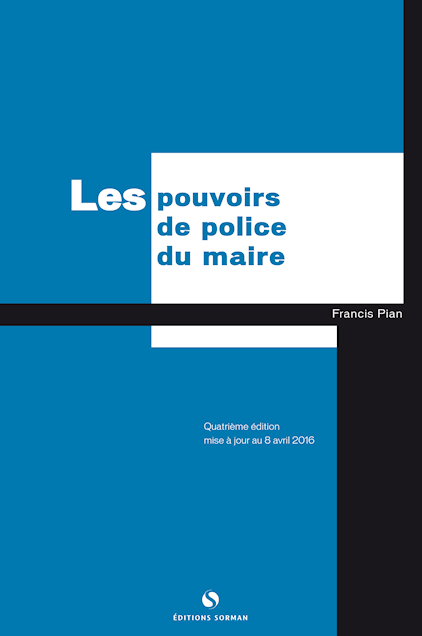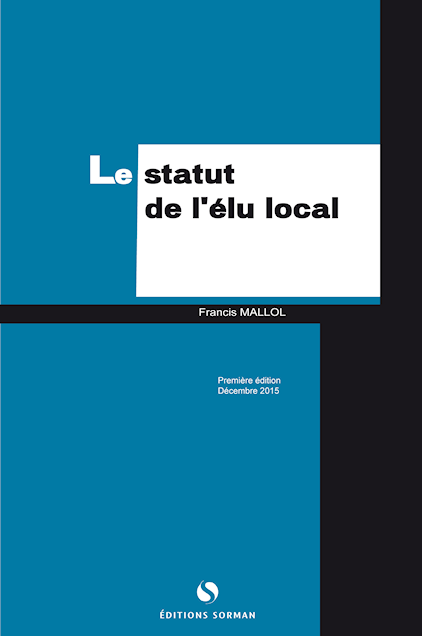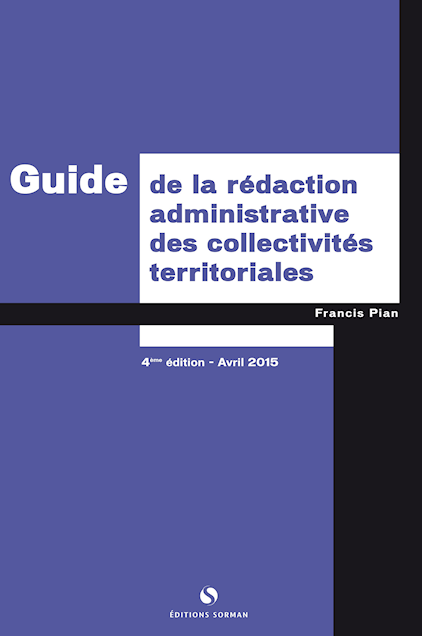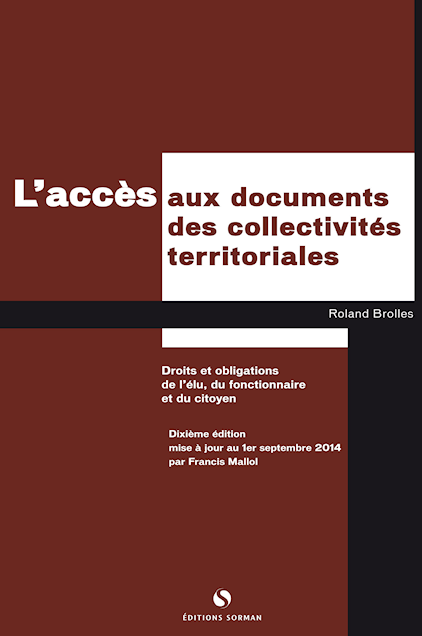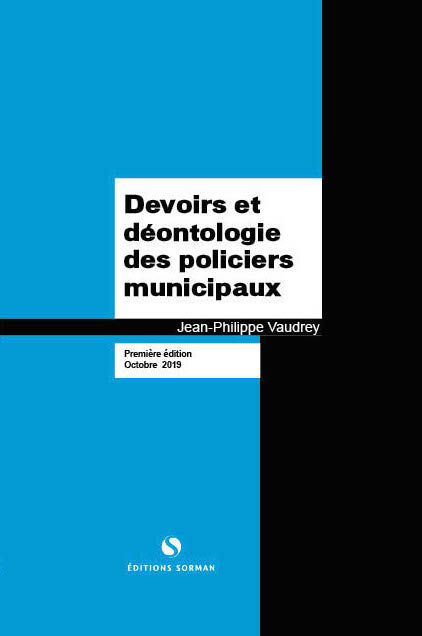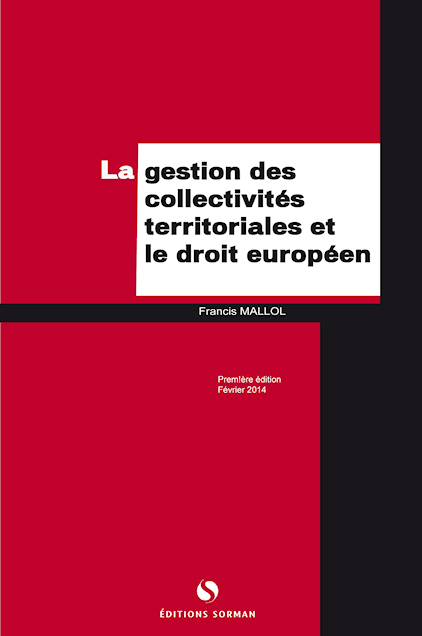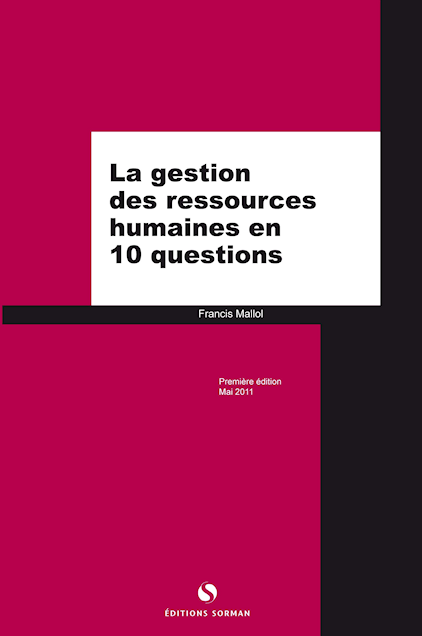Le plomb dans l’eau de consommation Abonnés
Le plomb a été largement utilisé pour la fabrication de canalisations publiques et privées d’eau potable. Avec l’évolution de la réglementation, il a cessé d’être employé dans les années 1960. Le plomb n’est présent qu’en quantité négligeable dans les ressources en eau superficielles et souterraines ; il est absent des captages et en sortie des usines de traitement. C’est donc au contact de canalisations en plomb des réseaux de distribution que l’eau a été progressivement contaminée. Le phénomène s’accentue avec la durée de stagnation de l’eau dans les canalisations, la longueur des canalisations, l’acidité de l’eau et sa température élevée. Le repérage par la collectivité ou son délégataire des canalisations en plomb est préférable à la réalisation d’analyses de l’eau.
Évolution législative et réglementaire
Le plomb et ses alliages ne doivent être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité et avec l’accord des autorités sanitaires locales. Il est également prohibé dans les revêtements des réservoirs d’eau potable et dans les installations de distribution d’eau chaude (règlement sanitaire départemental, 1963). La mise en place de canalisations en plomb dans les installations de distribution d’eau est interdite (décret du 5 avril 1995) ainsi que l’emploi de soudures contenant du plomb (arrêté du 10 juin 1996).
Risque sanitaire et toxicité
Les enfants, surtout ceux de moins de 6 ans, sont les plus exposés au risque d’intoxication par le plomb : 50 % du plomb ingéré passe dans leur sang contre 10 % chez l’adulte. L’imprégnation du plomb est accentuée par leur développement cérébral et l’intoxication peut débuter pendant la grossesse avec contamination du fœtus par le sang de la mère. Les conséquences lourdes : troubles cérébraux, ralentissement de la croissance, anémies et troubles neurologiques sévères en cas de fortes intoxications. Chez l’adulte, le plomb peut être responsable de douleurs abdominales, de troubles neurologiques, d’anémie et d’hypertension artérielle. Les cas de saturnisme sont aujourd’hui rares mais l’ingestion de plomb contribue à l’imprégnation de l’organisme.
Recommandations pour diminuer l’exposition au plomb
Des solutions permanentes existent, comme le remplacement des canalisations en plomb des réseaux publics et intérieurs par des matériaux métalliques ou organiques. L’application d’un revêtement protecteur de type résine conforme à la réglementation sanitaire permet également de limiter le contact entre l’eau et le plomb à l’intérieur des canalisations plombées, et se révèle moins onéreuse.
Les particuliers peuvent également être incités à des pratiques simples et efficaces : après stagnation de l’eau dans les canalisations, la laisser couler pendant une à deux minutes avant de la consommer ou de l’utiliser pour la boisson, la préparation ou la cuisson des aliments. Ne pas utiliser l’eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires, la température élevée favorisant la solubilité du plomb dans l’eau.
Dans les cantines et restaurants territoriaux, il est recommandé de n’utiliser l’eau du robinet pour la fabrication des denrées alimentaires qu’après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des canalisations du réseau intérieur de l’établissement.
Les analyses du plomb dans l’eau du robinet
À l’échelle nationale, l’Agence Régionale de Santé (ARS) contrôle la qualité de l’eau distribuée dans le cadre d’un programme de prélèvements et d’analyses réalisés par des laboratoires agréés par le ministère de la Santé (arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux fréquences et points de prélèvements). Le plomb est mesuré dans les captages d’eau avant traitement, et au robinet de consommateurs selon des modalités précises. À l’échelle territoriale, la collectivité ou son délégataire doivent localiser les canalisations plombées, évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l’eau et communiquer auprès des administrés concernés ou de demandeurs.
À noter : l’eau est classée en quatre catégories selon ses caractéristiques physico-chimiques et son impact sur le potentiel de dissolution du plomb dans les réseaux (arrêté du 4 novembre 2002). Les résultats de la mesure de la teneur en plomb dans l’eau varient selon la méthode de prélèvement utilisée, (circulaire du 5 février 2004). Pour garantir la fiabilité des résultats, faire appel à un laboratoire agréé par le ministère de la Santé. Le coût de l’analyse est à la charge du demandeur (environ 30 euros par échantillon).
Les aides pour les collectivités locales
Les équipements publics sont financés par le prix de l’eau. Le financement relève du budget des services d’alimentation en eau potable des collectivités. Dans certains cas, des aides peuvent être obtenues pour le renouvellement des canalisations des réseaux publics et des branchements publics en plomb : les aides des Fonds Structurels Européens (FEDER et FEOGA), la dotation globale d’équipement, les aides du Conseil Général pour l’alimentation en eau potable et les aides des agences de l’eau.
Marie Brevière
non signé le 12 mars 2015 - n°1034 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline