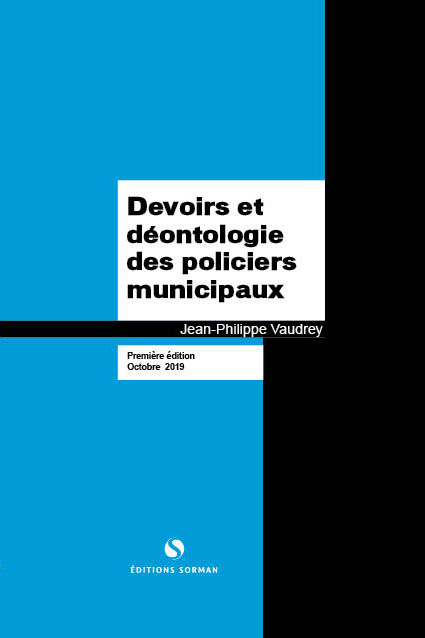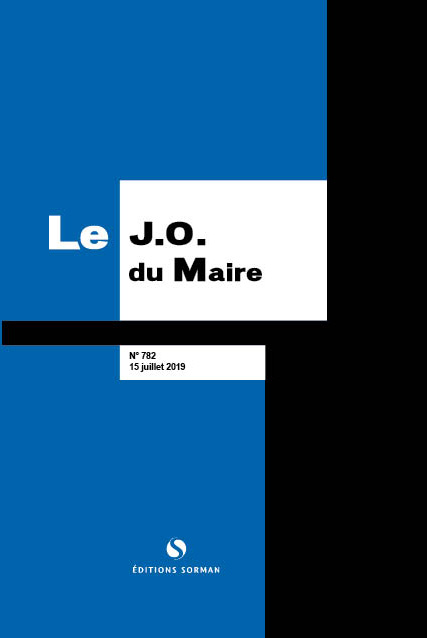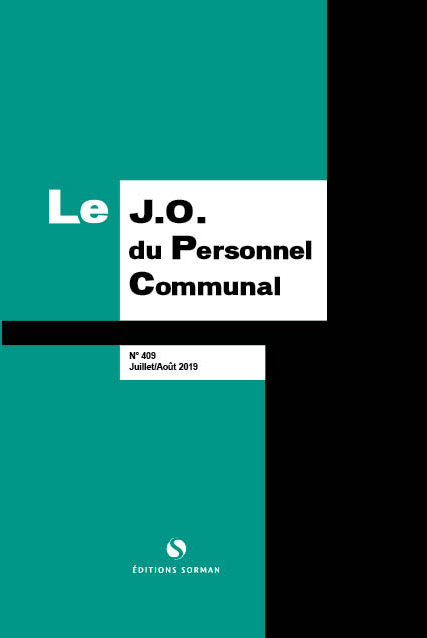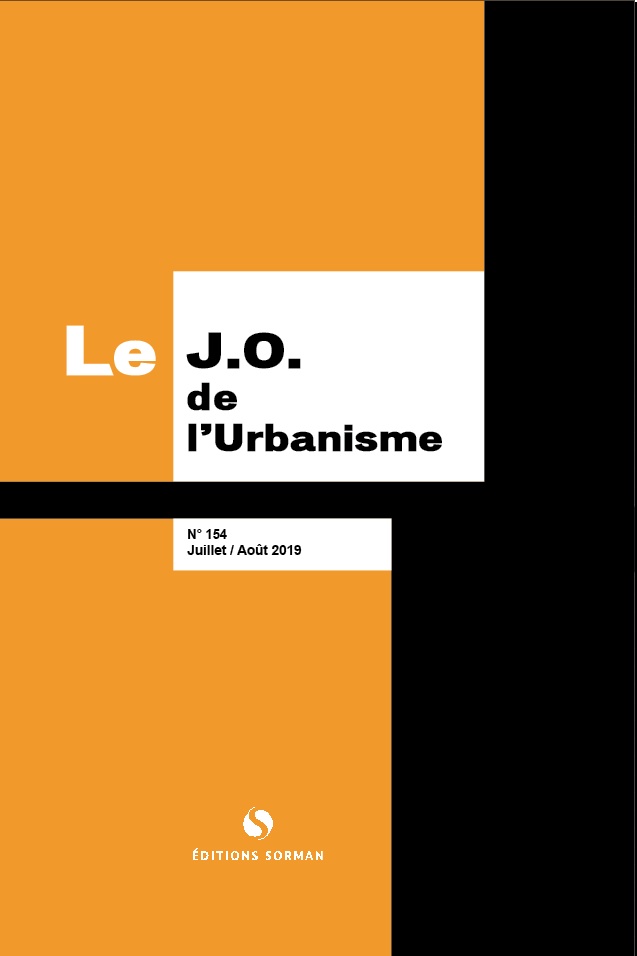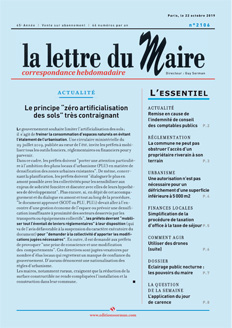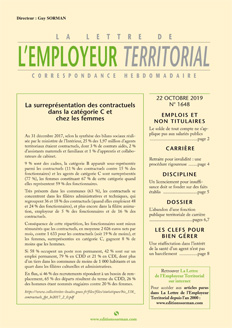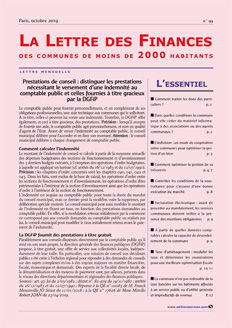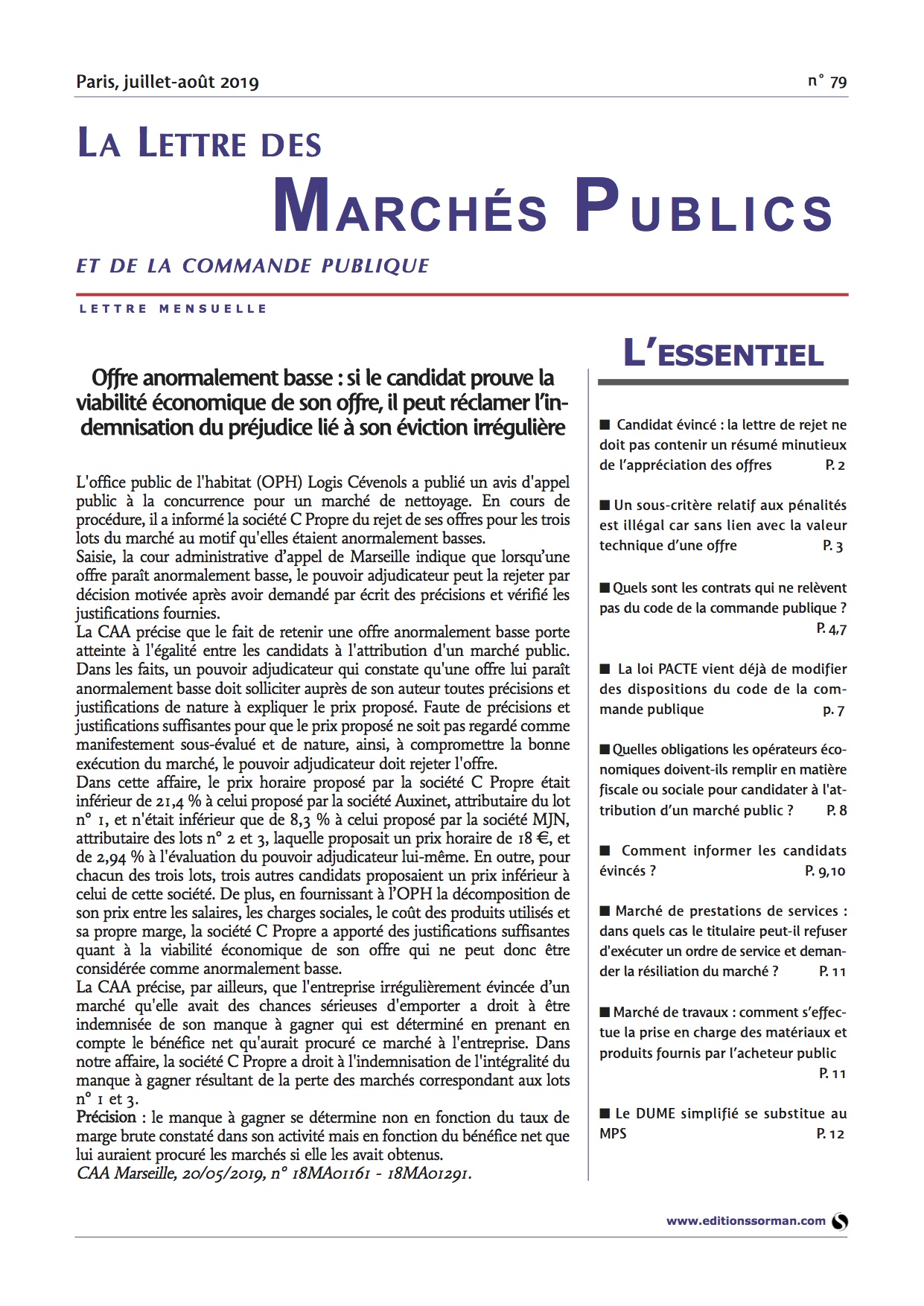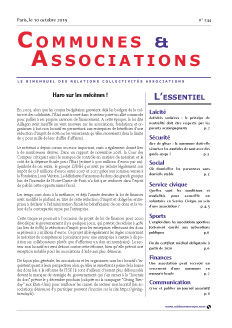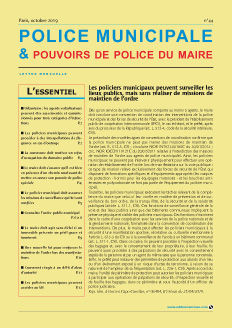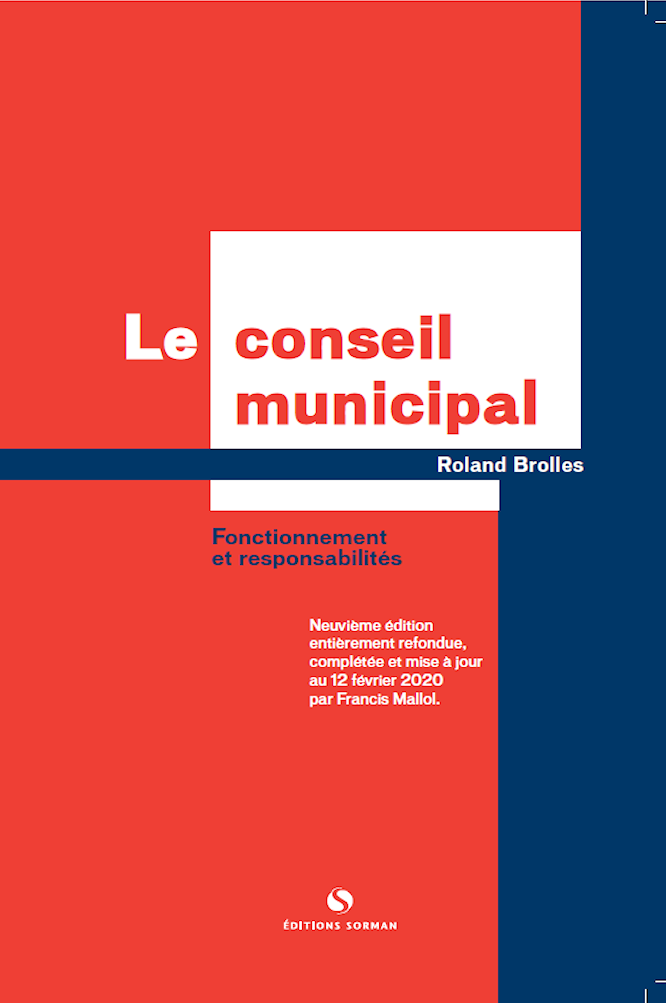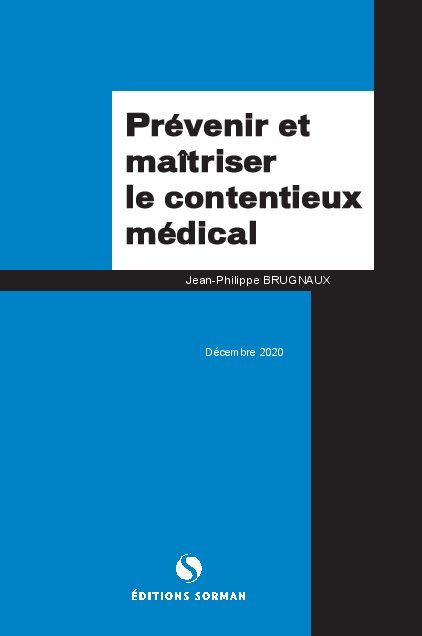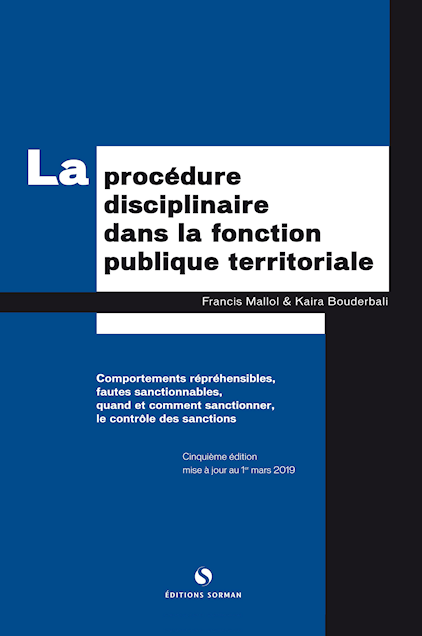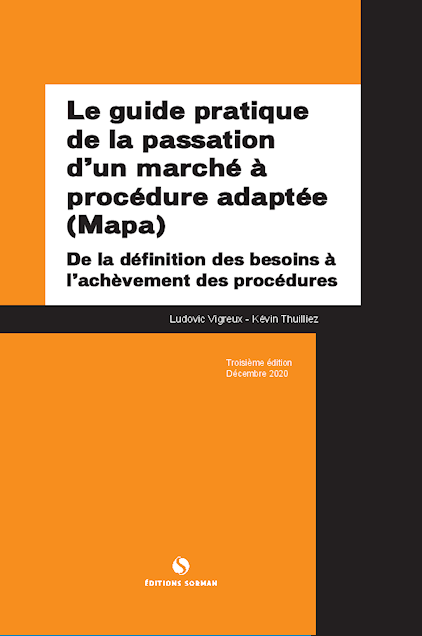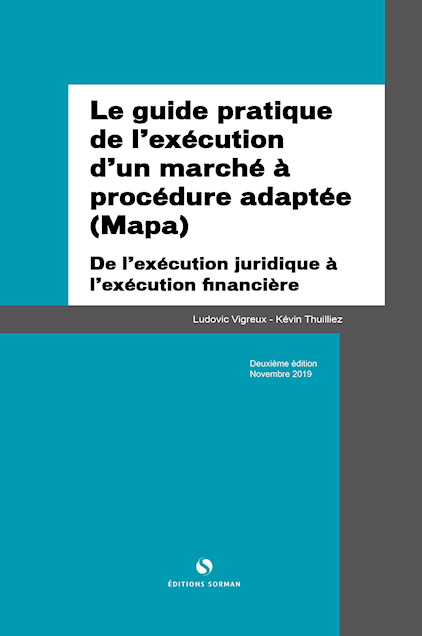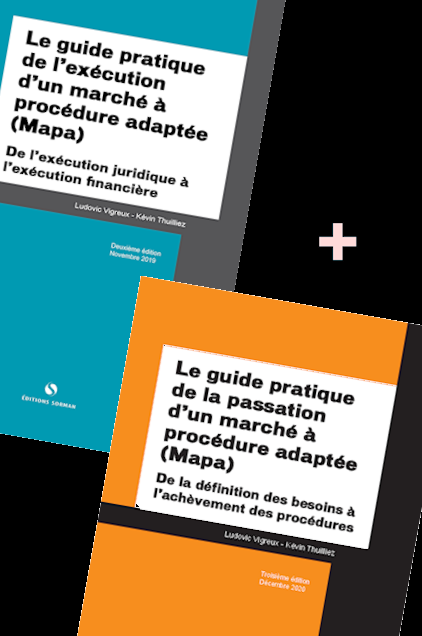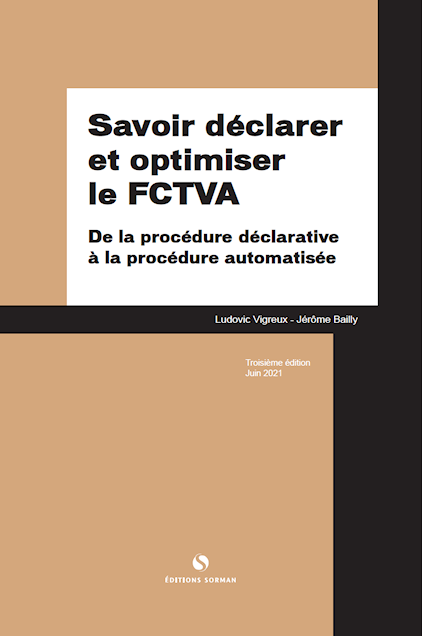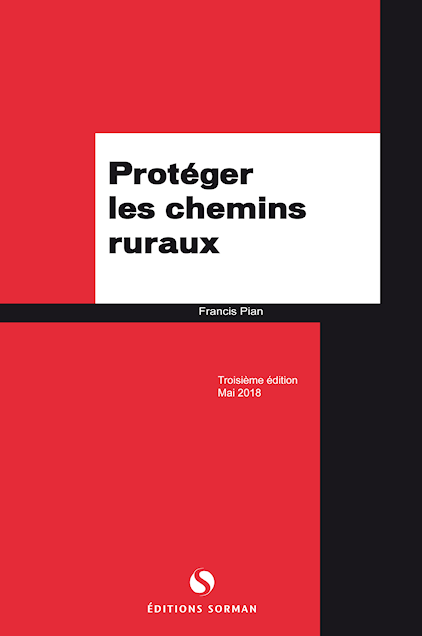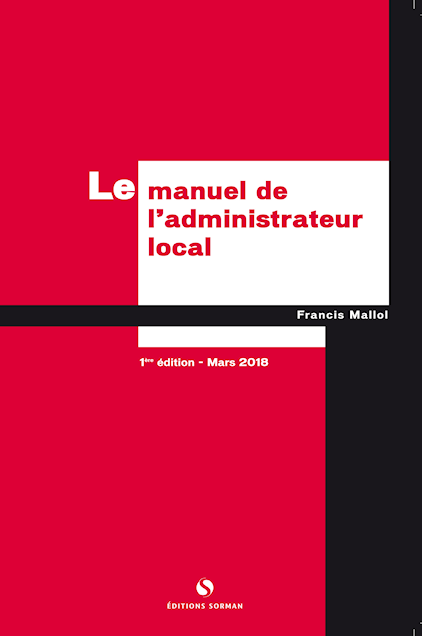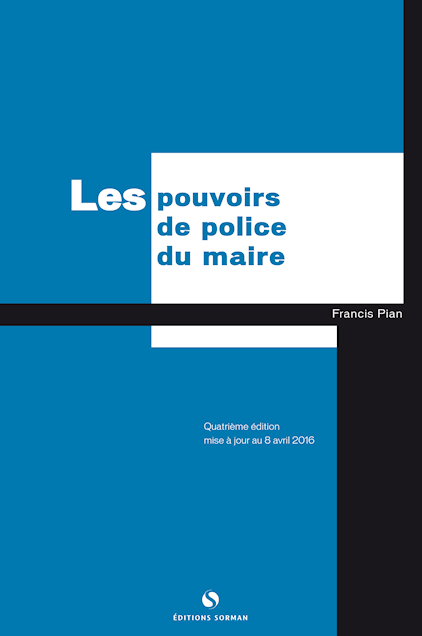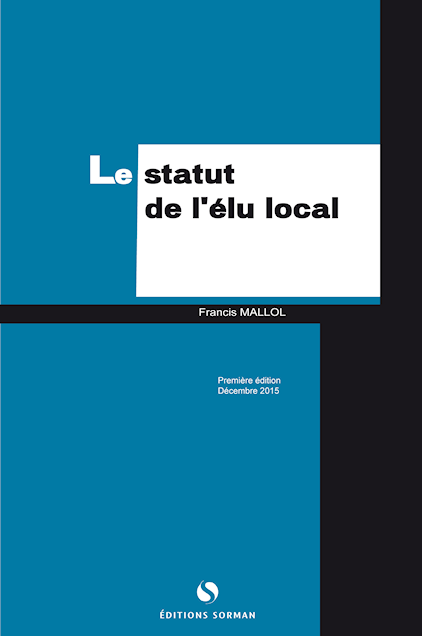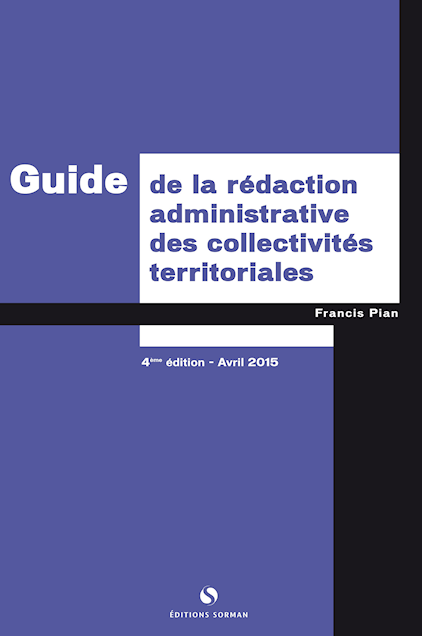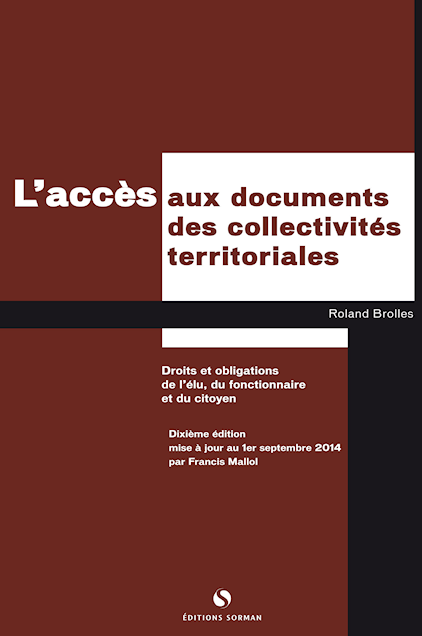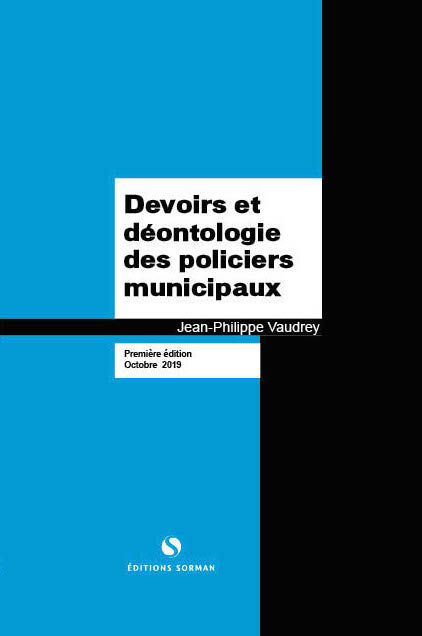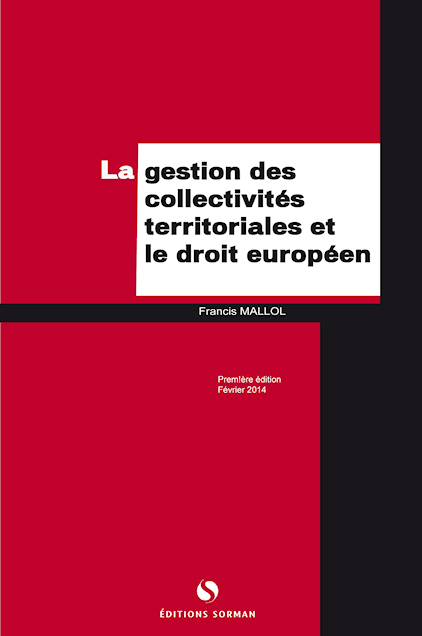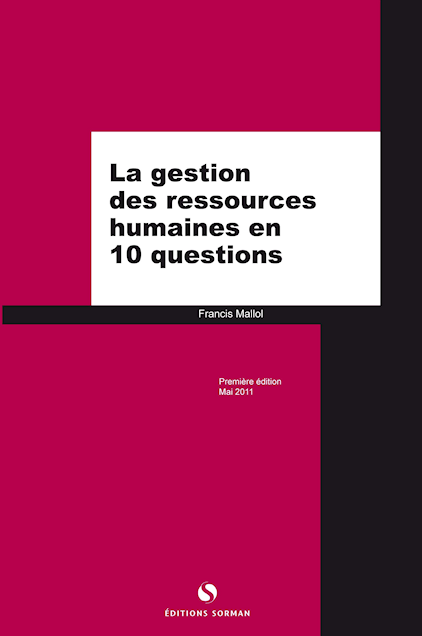Lutter contre la prolifération des moustiques Abonnés
Une grande variété d'espèces de moustiques cohabite sur le territoire national, présentant des différences d'habitat, de comportement et de période de développement. Cependant, leur cycle de développement est similaire et se distingue par deux périodes : une phase aquatique du développement larvaire et nymphal, et une phase aérienne, pendant laquelle l'adulte vole et s'accouple. Les œufs sont pondus soit à la surface de l'eau, soit sur un substrat humide susceptible d'être inondé ; ils peuvent alors demeurer à l’état de dormance plusieurs mois avant d'être submergés et d’éclore. Les larves se développent dans l'eau douce stagnante : marais, fossés pollués, fosses septiques, zones ombragées, du bord de mer aux altitudes élevées... Les moustiques adultes s'envolent à la fin mars, pour vivre plusieurs mois. En fin de saison estivale, leur vie se raccourcit à quelques semaines pour s’achever fin septembre. Seule la femelle fécondée pique pour récupérer les protéines indispensables à la maturation de ses œufs. Le rayon d'action du moustique s'étend jusqu'à quinze kilomètres. Deux facteurs sont donc indispensables à la prolifération des moustiques : la présence d'une eau stagnante et une température minimum. De fait, ils se développent aussi aisément en milieu rural (zones humides inondables, marécages, fossés...) qu’en milieu urbain (fosses septiques abandonnées, vides sanitaires, bidons de récupération des eaux de pluie...).
La démoustication
La lutte contre le développement du moustique se décline aux différents stades de son cycle de vie. Cependant, l’arrêt du développement des œufs et de la nymphe par des substances hormonales non sélectives est déconseillé, car elles ont un impact sur tous les œufs d'insectes et sur la faune. Il en est de même pour le traitement des moustiques adultes, dont l’éradication n’est envisageable qu’en cas de forte nuisance exprimée par la population. Il est donc conseillé de concentrer la stratégie de démoustication au stade larvaire, le moustique étant facilement localisable et occupant un espace restreint. Ainsi, il est recommandé de diluer dans l’eau le larvicide ingérable le plus sélectif possible, qui détruira la larve après ingestion (le « Bacillus thuringiensis israëlensis H14 » offre une sélectivité incomparable). Le traitement larvicide se décline à trois échelles : terrestre et manuel, terrestre et mécanisé ou aérien. Son choix est fonction de la surface des habitats, de son homogénéité ou de son morcellement, et de la densité de végétation naturelle. Pour les habitats de quelques mètres carrés, des traitements à pied et à l'aide de pompe dorsale de 15 litres sont réalisés. Lorsque la superficie des habitats est supérieure à plusieurs milliers de mètres carrés, des véhicules capables de transporter des cuves de 150 litres d’émulsion et des moteurs de pompes d'épandage sont utilisés. Si un écran végétal dense capte la pulvérisation du larvicide, il est recommandé de recourir à des engins chenillés. Lorsque la superficie des gîtes dépasse plusieurs hectares, des traitements aériens sont à envisager, permettant d'atteindre les points d’eau où se développent les larves, même sous un feuillage dense (environ 40 hectares traités à l’heure).
Distinguer milieux rural et urbain
La démoustication en milieu rural se déploie en deux étapes : d’une part, cartographier les groupements végétaux de zones humides sur le territoire et, d’autre part, entretenir la végétation des zones humides afin d'augmenter l'efficacité des traitements anti-moustiques, puis surveiller en permanence de début mars à fin septembre les fluctuations de température, ainsi que le nombre et le stade d’évolution des larves de moustiques, en vue d’identifier les moyens de traitement.
Complémentaire, la lutte anti-moustiques en zone urbaine concerne une multitude de petits habitats, proches des habitations, compliquant les visites et les traitements individuels. Il est conseillé d’informer et de sensibiliser la population sur l’application des gestes préventifs et sur l’efficacité du traitement larvaire au regard de la dispersion aérienne. Les nuisances dues aux moustiques peuvent être réduites par simple précaution, en les empêchant de passer à l'état adulte. Pour cela, deux solutions : éliminer l'eau qui permet son développement larvaire et, idéalement, éliminer définitivement le récipient. Sinon, traiter l’eau avec un produit larvaire approprié. Parallèlement, le traitement larvaire permet d’utiliser un produit biologique, tandis que le traitement de l’adulte impose la pulvérisation de produits chimiques, exigeant de strictes précautions d'emploi.
À noter : un plan de démoustication efficace s’accompagne obligatoirement d’un entretien des zones humides et du maintien ou de la création d’accès permanents à l’ensemble de ces zones, par déboisement, débroussaillement et fauche.
Marie Brévière le 11 mai 2017 - n°1082 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline